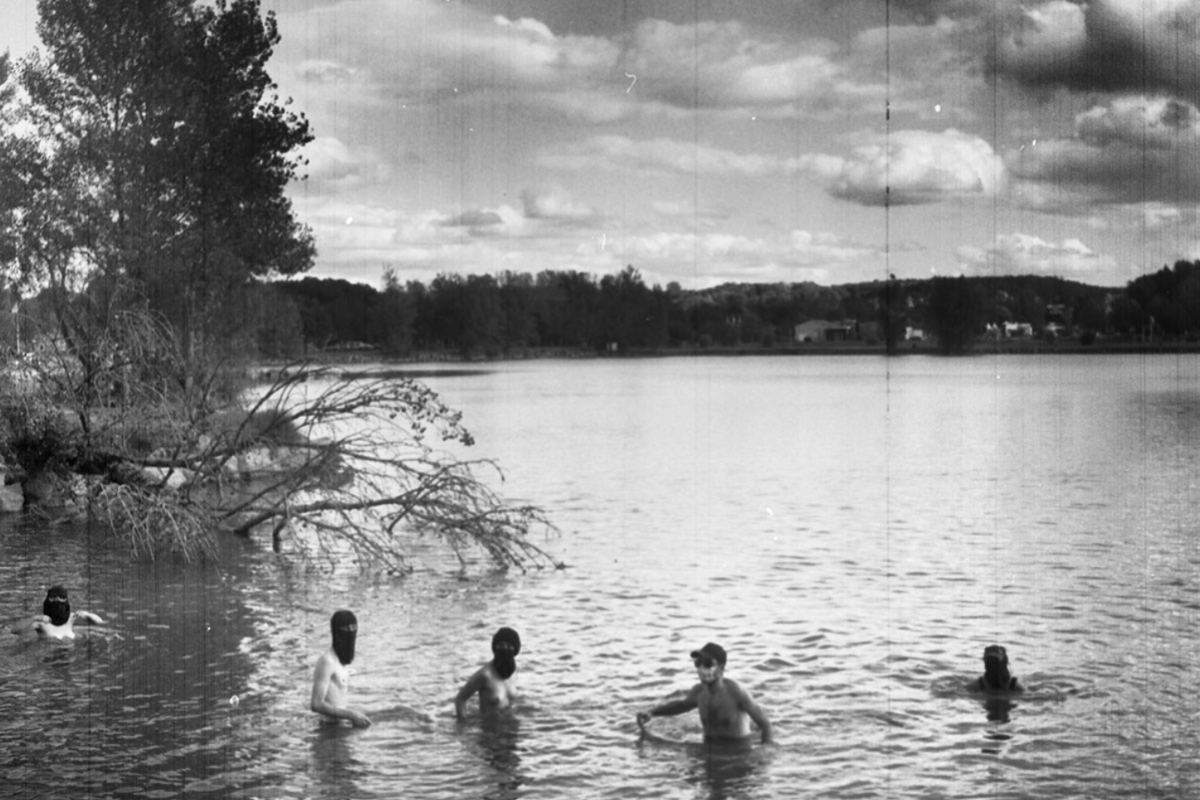Sauf à avoir fermé toutes les écoutilles, il était difficile, en ce mois de janvier 2025, d’échapper à la campagne de promotion du Lac de la création, le dernier roman de Rachel Kushner, sur les ondes, dans les journaux, les sites et les magazines. Lors de sa sortie américaine, quelques mois plus tôt, on s’était mépris sur sa relative discrétion quant à ses principales sources d’inspiration, l’affaire dite « de Tarnac » et un séminaire international autour de Jacques Camatte organisé près d’Eymoutiers en 2021 en plein confinement, auquel certaines connaissances de Kushner avaient pu assister. On avait pris ça pour de l’élégance quand ce n’était que pragmatisme : évidemment qu’il n’y a aucun bénéfice symbolique ni commercial à exciper d’une affaire inconnue de tous de l’autre côté de l’Atlantique. Le contenu du livre était stupide, plat et malveillant, d’autant plus qu’il voulait se donner des airs finauds, trépidants et empathiques. Mais que ferait-on de sa vie si l’on devait réagir à chaque roman oiseux ? On fut donc bêtement surpris quand survint la parution française, dont l’axe principal consistait à se prévaloir maladroitement de ladite affaire et d’on ne sait quelle intimité avec tel ou tel « communard ». Au point culminant de sa tournée, Kushner obtenait le 12 janvier un article dans Le monde des livres intitulé « “Le Lac de la création”, de Rachel Kushner : un lien ténu avec ceux de Tarnac »1, et contradictoirement sous-titré « Julien Coupat lui-même a tenté de convaincre l’écrivaine américaine d’écrire sur l’“affaire”. Elle a décliné. Avant de se lancer dans ce nouveau roman. » Le reste de l’article était à l’avenant. Laisser ces affabulations sans réponse, c’était les accréditer. Le Monde ayant décliné la publication du droit de réponse qui suit, nous ne pouvions que lui ouvrir nos modestes colonnes.
Que des écrivains ou des cinéastes en panne d’inspiration aillent prélever dans l’affaire dite « de Tarnac » la matière que l’imagination leur refuse, cela s’est vu maintes fois, et se reverra encore. Mais qu’une ambitieuse qui se décrit elle-même comme une « vendue » vienne de Los Angeles pour expliquer au Monde des livres que je l’aurais sollicitée comme « biographe officielle » et allègue une proximité inexistante pour ajouter un peu de crédit à sa prose superflue, voilà qui relève du plan com’ qui dérape. Je parle ici d’une femme assez stratège dans toutes ses interactions, assez dénuée de scrupules, assez rouée pour faire en sorte que l’exemplaire de son roman, réclamé de longue date, ne vous parvienne qu’après sa sortie américaine afin que vous ne puissiez contrarier la promotion d’un livre dont vous êtes manifestement l’un des antihéros, d’une Américaine dont la « prudence » va jusqu’à agrémenter cet envoi d’une lettre notifiant contre toute évidence qu’elle ne s’est pas inspirée de l’affaire en question, mais d’un ami à vous ; je parle d’une affabulatrice qui ne craint pas d’enrôler son mari dans son plan de carrière, en le présentant comme le traducteur d’À nos amis – ce qu’il n’a jamais été – et de L’insurrection qui vient – ce qu’il est si peu.
On comprend bien le besoin, pour ceux qui n’ont pas de vie, d’aller vampiriser ceux dont ils soupçonnent qu’ils en auraient une. Après Emily in Paris, après tout, pourquoi pas Rachel in the countryside ? Cela ne serait que médiocre s’il n’y avait aussi, chez pareils tenants du cirque médiatique, cette nécessité existentielle de discréditer ceux qui le récusent, ce besoin d’aller rattraper, au moins en effigie, ceux qui le fuient – et cette croyance qu’ils peuvent malmener impunément les obscurs. Cela fait penser à ces fans qui, s’interdisant eux-mêmes d’accéder à ce qu’ils idolâtrent, doivent de ce fait le détruire, à la fin. La façon dont Rachel Kushner s’est renseignée auprès de connaissances au sujet de mes habitudes, de mes proches ou de séminaires internationaux organisés clandestinement en plein confinement autour de mon vieil ami Jacques Camatte, ne dépare en rien des méthodes policières. Cette entrepreneuse de soi voudrait que l’infamie de prendre pour narratrice de son mauvais roman une flic infiltrée parmi les anarchistes sonne drôle, dessalé, post-moderne, cool, new-yorkais. Mais on ne se conduit pas moins en flic de l’assumer effrontément. On n’en est pas moins une vendue de le revendiquer. L’instrumentalisation culturelle ne fait ici que prolonger l’instrumentalisation policière, les voies de recours en moins. N’ayant aucun goût pour la publicité, je me serais gardé de répliquer aux affabulations de Kushner si tant d’autres avant moi n’avaient été la cible de son parasitisme littéraire, à commencer par Ben Morea dans Les lanceurs de flammes. L’époque est aux imposteurs, dit-on. « Chacun voit ce que tu parais être, peu sentent ce que tu es », observait déjà Machiavel. Mais cette seule conscience annonce la fin d’une telle époque. Les derniers jours sont malheureusement les plus pénibles car « avant la chute, on plastronne » – cela se sait depuis les Proverbes (dans la traduction d’Éric Smilevitch).
Julien Coupat