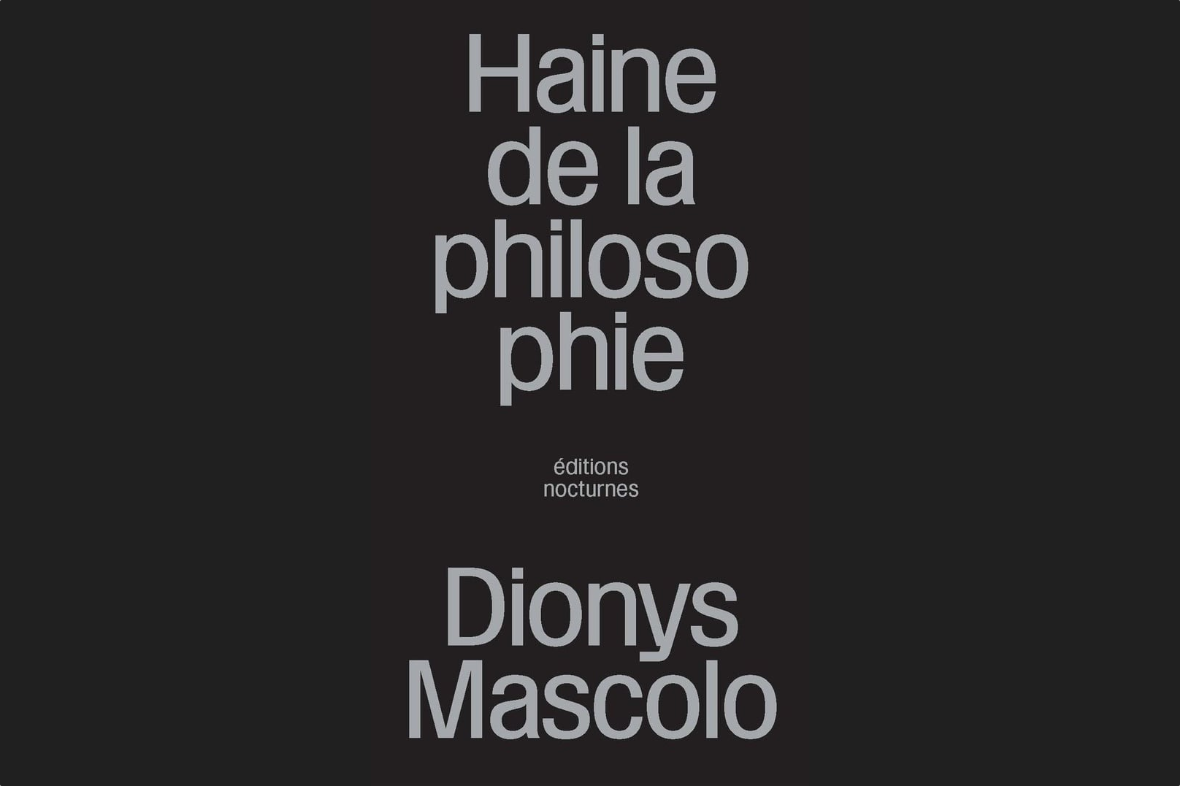Pour la republication de la Haine de la philosophie aux Éditions Nocturnes, nous proposons de republier cet entretien autour de son dernier livre. Nous remercions le site aphelis.net pour la bibliographie sur Mascolo et la mise en partage de cet entretien, originellement paru dans La Revue nouvelle, 1994, Vol. 99, no 4.
Contre la réduction philosophique au concept, Dionys Mascolo exalte la complexité, la passion de la vie, dans une pensée qui « se forme dans l’échange de parole ». Entretien avec Dionys Mascolo
La Revue nouvelle : Haine de la philosophie, pourquoi ce titre qui ressemble à une provocation ?
Dionys Mascolo : J’ai accumulé les arguments pour dire à quel point il fallait se méfier de la démarche proprement philosophique ; démarche réductrice de la pensée si on veut considérer la pensée dans la totalité des facultés qu’elle met en jeu. La démarche philosophique est une réduction des facultés de l’esprit, de l’âme. C’est une simplification suffisamment grave pour que la méfiance, le dégoût se changent en haine lorsque la philosophie prend une forme péremptoire comme chez Heidegger par exemple. Donc, haine de la philosophie comme Bataille a parlé de « haine de la poésie ».
R. N. : Le sous-titre de votre livre est « Heidegger pour modèle ». Pourquoi ce philosophe précisément ?
D. M. : Parce qu’il est le plus grand philosophe du XXe siècle, comme on ne cesse de le dire. Au passage, je dis combien j’ai été fasciné, séduit avant d’être fatigué, dégoûté, horrifié. C’est lui qui a poussé le plus loin la pensée de l’être par opposition à l’étant. Il est le fondateur de ce qu’on a appelé ensuite l’existentialisme.
R. N. : Heidegger, tout le monde le sait, a adhéré au nazisme et vous accordez moins d’importance à son discours du rectorat de 1933 qu’à son testament de 1945.
D. M. : Oui. Si j’accorde moins d’importance au Discours, c’est parce qu’on lui en a accordé plus, par erreur ou par tactique, pour mieux le préserver de notre dégoût. Dans le document de 1945, sa mauvaise foi éclate absolument. Je la décris longuement. Dans le discours de 1933, la citation d’Héraclite n’existe pas, pas plus que la citation d’Hölderlin. En 1945, il se camoufle sous ces autorités. C’est un plaidoyer d’une fourberie prodigieuse. Beaucoup plus que l’interview accordée au Spiegel en 1966, dont tous les commentateurs font état. Le testament de 1945 doit retenir toute notre attention parce qu’avec ce texte, nous nous trouvons devant le témoignage le plus clair sur le type de rapport qu’un esprit trop assuré de ses pouvoirs peut entretenir avec le siècle. Ce testament se présente comme une réflexion librement décidée sur des thèses soutenues douze ans avant, sans qu’à aucun moment le plus petit scrupule s’y dessine.
R. N. : Votre démarche tend à mettre un point final à la philosophie et vous assignez une seule tâche aux philosophes d’aujourd’hui, à savoir l’enseignement de l’histoire de la philosophie.
D. M. : En effet. Seuls ceux qui enseignent l’histoire de la philosophie ne sont pas, à mes yeux, suspects d’offenser la beauté des choses. Ils font un travail nécessaire comme les historiens d’autres disciplines. Ils sont des historiens et non pas des philosophes.
MORT DE LA PHILOSOPHIE
R. N. : La philosophie est donc morte.
D. M. : Elle est morte à moins de devenir très humble, c’est-à-dire d’avouer qu’elle est dans l’abstraction, dans l’obéissance rigide aux règles de la logique et qu’elle ne peut pas découvrir de vérités entières.
R. N. : D’où, à la fin de votre livre, le passage par le rire et « le penseur Raymond Devos », par l’amour ou encore ce détour par les surréalistes qui ont amené…
D. M. : Qui ont amené ce que j’appelle la pensée entière, par opposition à la pensée simplificatrice qu’est la philosophie ; mais, en effet, il est très remarquable que le rire, le jeu, l’amour, le désir, la sexualité n’entrent pas en ligne de compte dans les réflexions les plus profondes des philosophes et de ce philosophe en particulier.
R. N. : Et comme pour enfoncer le clou ou comme pour apporter un contrepoids à la suffisance de Heidegger, vous citez fréquemment Baudelaire, Nietzsche et Hölderlin. Quel est le lien entre ces penseurs-poètes ?
D. M. : La poésie tout simplement, c’est-à-dire la pensée qui ose tenter d’être entière en prenant appui sur toutes les facultés au lieu de procéder à la réduction philosophique, c’est-à-dire la réduction au concept. Par exemple, le mot homme est un concept, si vous employez le mot homme, cela veut dire qu’il ne s’agit pas d’une chaise ou d’un ours. Mais que devient le mot homme si je dis que, par exemple, François d’Assise était un homme et Hitler était un homme. Que devient le mot homme ? Il ne désigne pas la même chose, il désigne simplement quelqu’un qui est doué de langage, qui a la station droite, etc. Il s’agit donc d’une abstraction totale. Saint-François et Hitler appartiennent tous les deux à l’homme, mais vous voyez que le concept homme est vide sauf à l’opposer, encore une fois, à l’arbre ou au chien.
R. N. : En quelques pages, vous dites aussi votre méfiance à l’égard de la psychanalyse. Vous écrivez que si Rimbaud avait été psychanalysé, il n’aurait pas pu écrire ce qu’il a écrit.
D. M. : Vous connaissez l’essai de Freud où il traite le travail du deuil. L’être aimé est mort. Le travail du deuil, dit Freud, est le retour à la normale. Le travail du deuil consiste à redevenir normal en ne regrettant pas cet objet qui n’appartient plus au monde, c’est-à-dire qu’on n’a pas le droit de considérer que le mort appartient encore à la réalité, serait-elle intérieure. C’est pourquoi il m’est arrivé de dire que lorsqu’un être humain n’est pas vraiment atteint d’une névrose grave ou d’une psychose, la psychanalyse le guérit d’abord de ce qu’il y avait en lui de poétique. Ce qu’il y avait en lui de poétique, c’est ce qui lui permet justement de dépasser la simple logique, le simple respect de l’enchaînement des concepts, c’est-à-dire une pensée creuse. Et la psychanalyse en ce sens est dangereuse puisqu’elle vous guide vers le retour à la normale, à savoir l’indifférence, la placidité, la tranquillité d’âme.
R.N. : À la sérénité.
D. M. : À la Gelassenheit de Heidegger. Oui. Je faisais juste une analogie à ce propos avec la psychanalyse. La « sérénité » de Heidegger, c’est ne plus s’étonner de rien, ne plus se lamenter de la mort, ne plus être torturé par la liberté qui vous possède, parce que selon lui, la liberté vous possède, comme un démon. La Gelassenheit, c’est avoir sombré dans une sorte de sagesse indifférente, où plus rien ne trouble, plus rien ne scandalise, plus rien ne révolte.
LA PASSION DE VIVRE
R. N. : Vous citez la phrase de Nietzsche parlant des artistes : « Leur force s’arrête où cesse l’art et où commence la vie ; mais nous voulons être les poètes de notre propre vie, et d’abord dans les petites choses. » Que sont ces petites choses ?
D. M. : Ou on les néglige ou on en tient compte. En tenir compte, c’est simplement ne pas faire deux parts dans sa vie. Ce qui revient, d’une part, à exercer la pensée comme une faculté entière et, en même temps, ne pas se soucier de la conduite que l’on a dans la vie, dans le travail, dans la rue, dans l’amour envers autrui. Précisément, ce que je tente de mettre en évidence, c’est que Heidegger en particulier, et tout philosophe proprement dit, est conduit là : il fait deux parts dans sa vie. La conduite de sa vie importe peu : pour lui, l’adhésion au nazisme est un accident, une bêtise qui ne compromet pas sa pensée. Quand Nietzsche parle « des petites choses », cela concerne le comportement quotidien, la façon de manger, la manière de se conduire dans les rapports de paternité, dans les rapports conjugaux, etc.
R. N. : Dans les rapports d’amitié.
D. M. : Dans l’amitié, bien entendu. Le philosophe est donc artiste de sa propre pensée, mais pas de sa propre vie et Nietzsche, qui n’est pas un philosophe au sens exact du mot, propose comme projet d’être l’artiste de sa propre vie, c’est-à-dire d’être en soi un objet qui doit tenter de cultiver la perfection, ce qui n’est pas un souci philosophique.
R. N. : Comment avez-vous surmonté la contradiction qui consiste à rejeter le « jargon » philosophique tout en devant l’utiliser pour en dire la vanité ?
D. M. : Je le dis au passage. Pour tenter vraiment de convaincre que la philosophie doit être soupçonnée, il faut hélas emprunter ici où là une démarche quasi philosophique, sans que son aboutissement ne soit vraiment philosophique puisque, après avoir employé par nécessité tel ou tel concept, on en vient à le nier. Je l’ai employé, très bien et après je le mets à la poubelle.
Il a servi et je le rejette ensuite, autrement dit, je n’y crois pas. Le concept est un passage obligé, mais il doit être abandonné après avoir été utilisé, comme on utilise un véhicule.
R. N. : Si je vous dis qu’à mes yeux votre livre exprime une formidable exaltation de la vie, un « bonheur » de vivre, comment réagissez-vous ?
D. M. : Un bonheur de vivre ? Il m’importe peu que ce soit bonheur ou malheur. C’est plutôt la vie dans sa complexité, dans sa plénitude, dans toutes ses sensations, dans toutes ses facultés, dans tous ses affects – par opposition aux concepts –, la vie dans la totalité de ses possibilités. Je parle souvent de l’avenir de l’homme, je dis que l’hominisation est toujours en cours, que nous ne sommes pas encore les hommes entiers que nos arrière-petits-fils deviendront peut-être, que nous ne sommes pas encore tout à fait sortis des cavernes, de l’animalité première. Dans ce sens-là, les refus, les indignations, les révoltes désignent ce que je nomme un inconnu que j’appelle inconnu désirable : le désir puissant de quelque chose qui n’existe pas encore et qui est en l’homme comme une possibilité. C’est pourquoi vous parlez de bonheur, mais je ne dirai pas bonheur, la passion n’est pas nécessairement heureuse, mais tout ce qui brime la passion est une amputation.
UN COMMUNISME DE PENSÉE
R. N. : Je voudrais aborder votre deuxième livre, À la recherche d’un communisme de pensée. Que signifie ce titre ?
D. M. : « Communisme de pensée », je le mets sous le signe de Hölderlin : « La vie de l’esprit entre amis, la pensée qui se forme dans l’échange de parole de vive voix ou par écrit, sont nécessaires à ceux qui cherchent. Hors cela nous sommes pour nous-mêmes sans pensée. » Le communisme de pensée veut dire : le partage de pensée avec ceux qui précisément ont la même conception de la pensée, qui ne doit être amputée d’aucune de ses facultés, mais qui doit les mettre en œuvre toutes à la fois. C’est difficile. C’est dangereux. Il y a aussi des poètes qui font acte poétique, mais qui simplifient même l’acte poétique. C’est-à-dire qu’ils sont des philosophes déguisés en poètes, des tricheurs.
R. N. : Ce livre est un recueil de textes dont le premier, Si la lecture de Saint-Just est possible, date de 1946. Pourquoi ce livre ?
D. M. : Des amis m’ont convaincu de rassembler des textes aujourd’hui introuvables, comme la Préface à l’Antéchrist ou des textes sur le surréalisme. Et je dois dire qu’en relisant les épreuves, j’ai été confirmé dans le choix de ce titre, car par trois fois je parle de « communisme de pensée » et il m’a semblé qu’aucun de ces textes n’était contradictoire avec l’ouverture vers un partage de pensée ; ce n’est pas une pensée solitaire, c’est la recherche d’un accord sur des points qui intéressent chacun. Tous ces textes me semblent aujourd’hui avoir une constante : une recherche qui vise à atteindre un partage de pensée.
R. N. : Ce n’est pas loin de la fraternité et, dans Haine de la Philosophie, vous parlez de « frère Hölderlin ».
D. M. : La fraternité est un concept un peu creux. J’ai des frères et sœurs, je leur ai toujours dit que nous serions amis ou rien, pas frères. S’il n’y a pas partage de pensée – s’ils ne sont pas amis – ils ne sont pas frères. La fraternité de sang ne m’intéresse pas. Et « frère Hölderlin », il faut l’entendre dans le sens du partage de la foi, c’est comme frère François (d’Assise), sœur Thérèse (d’Avila), frère Jean (de la Croix).
R. N. : Pour ce livre aussi vous donnez un sous-titre, « Entêtements ».
D. M. : Je veux dire que ce ne sont pas des pensées de type philosophique dictées par des concepts de la logique. C’est un mélange d’intuitions, d’aperçus, d’hypothèses, tous hasardeux, incertains, qui, peu à peu, par leur permanence ou leur répétition, finissent par entrer dans la tête, finissent par vous « entêter » et par devenir l’équivalent de « pensées », mais qui à l’origine n’étaient pas des pensées, mais des humeurs, des révoltes, des dégoûts, des désirs.
Propos recueillis par Jean-Marc Turine.
Parution 20 février 2025
Haine de la philosophie
Heidegger comme modèle
Dionys Mascolo
Format 126 x 222 mm, 200 pages
ISBN : 978-2-488331-01-2
22 €
Collection : Éthique de la pensée
Édition : Éditions Nocturnes