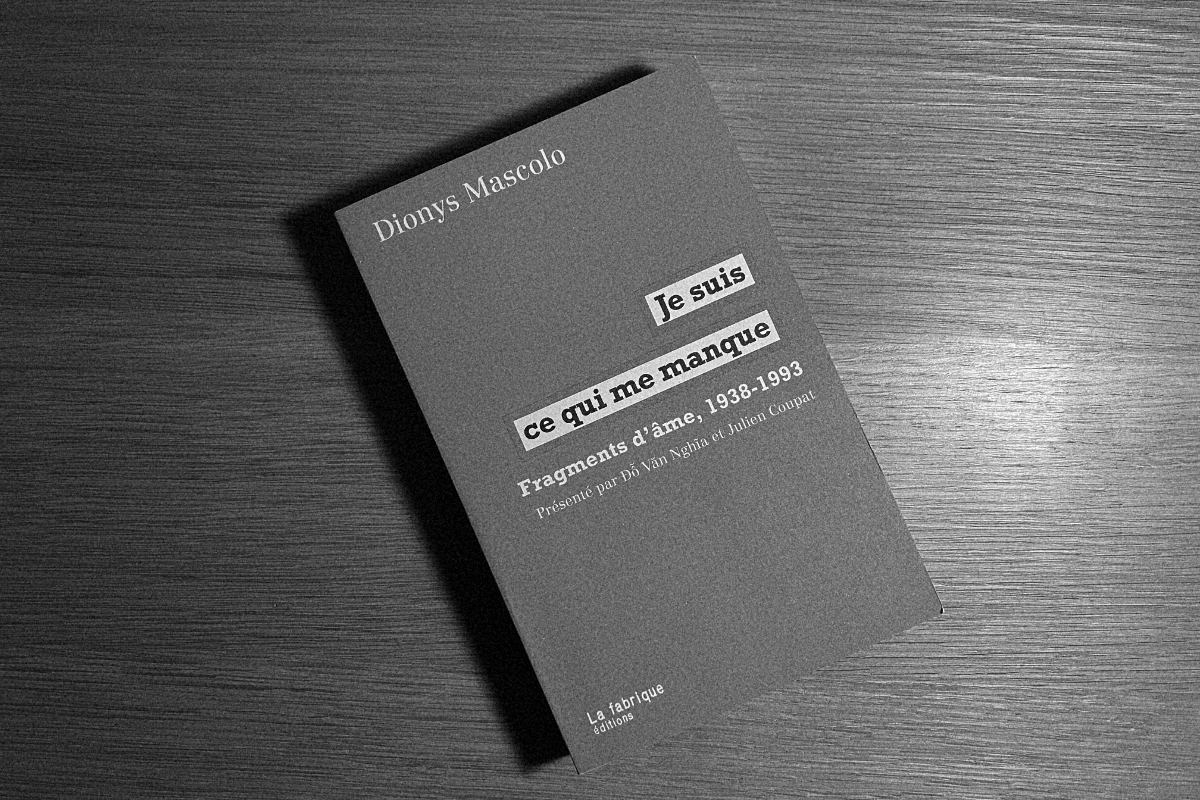Au sujet du livre Je suis ce qui me manque de Dionys Mascolo.
Je suis ce qui me manque vient de paraître aux éditions La Fabrique. J’ai eu l’occasion d’entendre lire, puis de lire à mon tour, les fragments d’âme choisis qui composent cet ouvrage. En différents lieux, depuis différentes situations, qu’il s’agisse d’une nuit entre amis, d’un long trajet ou depuis la solitude d’un coin de pièce peu éclairée. Je suis ce qui me manque est un livre qui ne se termine pas, un livre fait de débuts, depuis lesquels il nous est proposé de débuter encore, à notre tour. C’est un livre qui accompagne. Je connaissais Dionys Mascolo depuis Le Communisme, Lettre polonaise : sur la misère intellectuelle en France, Autour d’un effort de mémoire : sur une lettre de Robert Antelme, puis par l’excellent Entêtements paru aux éditions Benoît Jacob, auquel il faut évidemment ajouter La révolution par l’amitié, recueil de textes paru en 2022 aux éditions La Fabrique, livre nécessaire qui regroupe notamment Si la lecture de Saint-Just est possible, Refus inconditionnel, La part irréductible, Sur le pouvoir temporel de l’intelligence… Je ne vais pas tous les citer ici, mais il faut tous les lire. Ce que j’ai pu comprendre de Dionys Mascolo, et depuis ces lectures, donc depuis ses textes, c’est la proposition mise en partage d’un communisme sensible, inouï. Je peux dire sans trop de honte que j’y ai trouvé une camaraderie rare, une complicité distanciée par le livre, suggérant quelque chose de proche, faisant écho ou appel. Ce quelque chose m’est encore assez difficile à nommer, c’est un quelque chose qui se passe de citation, puisqu’il ne se réfère pas à ce qui est écrit, mais bien à ce que l’écrit dit en dehors de sa propre matérialité, c’est à dire en dehors du matériellement lisible. Et cet en dehors du lisible, j’ai su le reconnaître là où un communisme véritable prenait vie, il ne s’agit pas d’une impression, mais bien d’une expérience depuis l’impermanence. Au fil de mes lectures, j’ai choisi de retenir quelques fragments et de les partager ici. L’ouvrage est dense, on peut y cheminer sans attache chronologique, sans attention à sa mise en parties. D’ailleurs, ma sélection est assez injuste, pourquoi tel fragment plutôt qu’un autre, tout est à refaire. Il ne serait pas impossible que Je suis ce qui me manque puisse parfois produire l’effet d’un miroir pour le lecteur, lecteur aussi nombreux qu’il puisse exister de figures et de vérités contre-dites. Ce livre témoigne d’une jonction permanente entre l’intime et le commun. La tenue dans le temps d’un geste plié aux contradictions de l’écriture. Bien trop souvent, on prend l’habitude de nous annuler, de ne rien conserver de ce genre de témoignages. Mais voilà, ces carnets que l’auteur (sic.) a su tenir une vie durant, accompagnent dans l’ombre tous ces autres textes cités plus haut. Il faut désormais comprendre l’un avec l’autre, et non l’un séparé de l’autre. Il ne s’agit pas ici de « poétique » ni de « politique », laissons les genres à ceux qui en ont encore besoin. Il faut comprendre qu’il n’y a pas de spécialisation du regard comme il n’y a pas de spécialisation de la critique, que le refus, une sensibilité tenue et ténue, cette présence au monde, embrassent un mouvement plus vaste, un mouvement vital, une forme sans fin, qui se doit d’être notre perspective, celle d’un art de vivre, aussi difficile soit-il de le tenir, sans compromission pour cette triste civilisation, depuis notre profonde et coriace insatisfaction. Merci à ceux qui ont œuvré pour la transmission et le partage de ces fragments d’âme dont vous trouverez ici quelques extraits.
Justin Delareux
« Aujourd’hui 4 février 1939, j’ai décidé de commencer à écrire mes mémoires, depuis cet âge de 23 ans moins 7 jours et pendant les 50 ans qui me restent peut-être à vivre.
… Contraire d’un travail artistique. Rien qu’une suite de rapports exacts. Compte-rendu. Il suffisait d’y penser, d’avoir le toupet, la sottise de ne pas savoir vivre une minute sans vouloir la conserver par quelque moyen, pour que chacun puisse aussi faire peut-être, de rien, quelque chose de passionnant.
… Je ne sais pas l’allure qu’auraient ces “Mémoires”. Mais plus j’y pense, plus il me semble qu’une telle entreprise était nécessaire. Tentative dont je ne saurai rien avant longtemps, pour faire directement d’une vie une œuvre. Transposition immédiate de toute “ma vie” en œuvre. Pas d’invention, d’où économie, etc. Pas à attendre d’inspiration.
… Une œuvre d’art est toujours une exagération. Transposant sous des œuvres successives ses propres virtualités, on en oublie ce que l’on est en fait. Étant entendu que ce que l’on est en fait n’est peut-être qu’une virtualité d’un certain genre.
Ce sera surtout, pour moi, m’interdire tout à fait de m’oublier, de me laisser aller. Cela me donne un peu de fièvre – gigantesque élargissement de ce que j’ai à faire. L’idée m’est venue comme une révélation. Aller jusqu’au bout des choses. »
La Grèce : utiliser la parole, non pour dire ce qui est, mais pour mettre en doute ce qui est.
Les Grecs ont inventé le doute (cf. Dumézil).
« Tenir au “journal intime”.
Le trouver trop peu intime. Trop apprêté, littéraire, fabriqué.
En ouvrir un deuxième à côté du premier.
N’en être pas satisfait. Plus intime, audacieux (secrets dévoilés), mais encore plein de choix.
En ouvrir un troisième, en plus des deux autres, toujours valables dans leur genre, se rapportant à des publics divers.
N’en pas être non plus satisfait, trop de choses non nécessaires y étant dites.
Toujours poursuivant les trois premiers, chacun correspondant à un genre, chacun ayant son possible “lecteur” – en ouvrir un quatrième, où seraient dites moins de choses, les seules vitales, constructives ou constitutives de l’être, fragments d’âme.
Cela, trop encore : complexité encore dérisoire (tout est plus simple que ça).
En ouvrir d’autres – et puis, un dernier.
Sur celui-là, le journal enfin de moi : rien ne serait jamais écrit.
Conquête du silence, conclusion de la recherche sur ce que je puis bien être. »
Le langage est un phénomène religieux. Je ne commence à parler qu’en tremblant. Je me répugne ayant parlé. Rire, après, qu’il vous arrive d’avoir, atroce.
Au fond, je m’en aperçois, ce que je fais depuis trois ans, sous couleur de « connaissance », n’est jamais que de chercher à isoler dans leur pleine valeur ou éclat métaphysique des sentiments, les peindre, – non des idées. Ce serment que je m’étais fait, de ne rien dire que ce que j’avais fait, de ne parler que pour dire ce que j’ai fait, suis prêt à faire – de ne jamais employer le langage qu’à faire la théorie de ce que l’on a fait (vécu) –, peut-être n’arriverai-je jamais à le tenir – mais, même alors, ce serment que je crois quelquefois que j’ai déposé, dominera encore tout ce que je pourrai trouver à dire, en fera la tonalité.
« Certaines personnes sont peu sensibles à la poésie. Elles se consacrent en général à l’enseigner », dit Borgès. Fort bien dit, bien qu’excessif. Plus juste serait de dire : « c’est principalement parmi les personnes peu sensibles à la poésie que se recrutent ceux qui se consacrent à l’enseigner ».
Extraordinaire, le nombre de choses qui ne méritent pas d’être dites.
Les psychanalystes : ils sont intimidés dans l’âme. Manque d’audace intellectuelle étonnant, de tous.
Rien du monde ne me satisfera jamais (janvier 1939, Champde-Mars). Haine pour tous ceux qui veulent me rassurer.
Ce n’est peut-être pas par les voies de l’exactitude, hélas, que l’on a le plus de chances de débusquer quelque vérité essentielle, mais bien plutôt, d’approximation en approximation, suivant cependant les flèches d’une intuition aussi profonde qu’obscure, par les voies les plus douteuses, sinon suspectes, celles d’une démarche qu’il faut bien appeler « poétique », jusque dans le sens où « poésie » est digne de mépris ou de dégoût (comme fuite ou présomption). (…)
Bourgeoisie. – Ce sont les juges, le respect des lois. Ils jugent tout, les actes et les pensées, les intentions, les secrets, les sacrifices, les suicides, les héroïsmes, les abandons, les désirs, les regrets, les rires – ils jugent la grâce, le gratuit, le jeu, tout ce qu’il y a d’enfance inutile au monde, l’inutile, l’injustifiable, le divin injustifiable dans la marge duquel se développe tout ce qu’il peut y avoir réellement de vie – les ouvriers de la dernière heure, la chance.
L’enthousiasme, seul état d’âme supportable.
Il faut que l’enthousiasme soit accessible à tout moment.
16 juillet [1940]
Reconnaissance pour tous ceux qui m’ont abandonné.
Naissance de la destinée. Reconnaissance pour le monde, de ce qu’il soit ce qu’il est, de ce qu’il vous abandonne si bien. Joie à me souvenir des poings fermés, des larmes retenues, des mains qui prennent la forme de poings rien que contre elles-mêmes. Joie à me souvenir de toutes mes peines, de tout ce manque de réponse épouvantable, féroce.
Rester pauvre et toujours ignoré.
Balzac (Modeste Mignon). – « Quoi que le malheur fasse pour développer les vertus, il ne les développe que chez les gens vertueux ».
« Culture ». – On ne peut être préfet de police aujourd’hui sans avoir lu Rimbaud !
Je n’oublierai jamais que d’écrire se fait à quelqu’un qui n’est pas là.
C’est toujours de l’autre monde qu’on écrit (comme à quelqu’un).
Jeunesse : ces efforts exténuants, tant d’années, rien qu’à ne pas déborder. S’exercer à la froideur, au calme, au sourire, par-dessus l’unique désir : de lancer la bombe.
Plus fatigués d’avoir tant dû nous contenir que d’avoir lutté ou travaillé.
Ou : notre seule lutte : pour nous contenir ; et notre seule construction notre retenue.
L’insupportable ton de douceur des hommes d’Église – même lorsqu’il s’agit de dire des choses terribles. Leur sourire !
Ma douleur, à vingt, vingt-cinq ans. Un objet de désir (amour, connaissance) qu’il faille le vouloir ! Repousser tous ceux qui exigent d’avoir été voulus pour se donner (j’aurais dit : Dieu même). Exigence d’innocence terrible : ne rien posséder de voulu.
« Je suis ce qui me manque ». J’ai cela écrit à l’intérieur du front depuis l’âge de vingt ans. Qu’ai-je à faire avec cela de m’intéresser à la « castration » ?
Si j’aimais nager très loin, c’était pour la jouissance de pouvoir me dire ce que je savais : que nuque au ras de l’eau, l’intérieur de ma tête était plus vaste que la mer. Pour, le sachant, l’éprouver.
Catholiques. Propriétaires. – Propriétaires de leur Dieu. Ils nous invitent à nous promener avec eux dans leur parc – leur Église – leur Dieu. Comme on fait pour séduire le jeune homme pauvre, anarchiste et fier.
Devant les athées, méfiance. Ils refoulent. En deçà de l’acte négateur.
Le oui (nietzschéen) n’existe que comme effet du négatif (du besoin, du manque), lequel est le seul correctif possible du nihilisme (de l’entropie). C’est parce que je vis le manque que je ne m’abandonne pas au désespoir, à l’à quoi bon. Le nihilisme est encore un état de satisfaction (pseudo-satisfaction). Non pas la « grande affirmation » donc, mais la positivité, la plus modeste, de l’insatisfaction, souffrante, manquante, et qui s’avoue. Voilà le juste.
La musique, seul langage qui ne soit pas susceptible de vieillir affreusement vite. C’est que ses éléments n’ont aucun sens. Il n’y a pas de dictionnaire de ce langage. Rien n’est condamné d’avance à un sens. Rien n’est un mot. Elle ne veut rien dire. Pas la confusion comique qui fait que celui qui ne comprend rien croit encore comprendre ce que cela veut dire, s’il s’agit de mots. La musique d’une écriture ne s’élève donc pas d’une combinaison de sons, mais d’une combinaison de sens. C’est soustraire à la tyrannie du signe la signification, en jouant sur tous les sens possibles. Ce qui est dit n’est pas le vrai. Mais seulement ce que veut dire ce qui est dit peut être le vrai. Il n’y a aucun moyen qui permette de dire directement ce que l’on veut dire. Seul ce qui est dit pour signifier autre chose peut dire quelque chose. Mais ce qui est dit pour dire ce qui est dit, ne dit rien.
D’où qu’une définition de la musique peut le mieux servir à définir l’art lui-même.
Moins le signe a de sens en lui-même, plus la signification aura de chances d’être libre.
Naissance de l’intelligence : à cinq, six ans l’enfant saisit que le langage sert aussi (surtout !) à mentir : puissance. Les troisquarts de la littérature en sont à ce stade (la découverte de ce pouvoir). Littérature infantile (prestige, empire).
« Les vrais sages meurent de colère » (Kraus, proverbe arabe).
La question sociale, je peux la poser, pour moi, en ces termes : Pour ne pas mourir de dégoût, repousser tout ce qu’ils vous proposent. Et alors risquer de mourir de faim. Le monde actuel : où celui qui n’en vient pas très vite à risquer de mourir de faim peut être mis en accusation : il fallait qu’il ne soit pas dégoûté.
Ce qui est dégoûtant dans le christianisme, c’est de croire que c’est arrivé. Le séduisant du judaïsme, c’est l’attente. Avec le christianisme, les jeux sont faits : le sens de l’homme, du sacré, de la condition humaine, donnés. « Tout est accompli », en somme, pour l’esprit. Et le salut, individuel, est le travail à faire. Dans le judaïsme, le sens est à venir. Et le salut, collectif, ou rien. Communisme.
L’idée communiste, et le « communisme réel ». Même distance entre l’idée surréaliste et le « surréalisme réel » – le groupe,
ses dogmes et ses rites, sa scolastique, ses fureurs contre les hérétiques, et, surtout, le fait qu’il se soit laissé enliser du côté des œuvres (cf. Bataille), du musée, des arts plastiques.
Dans le mouvement communiste aussi la paresse théologique a joué son rôle : l’idée (post-hégelienne) que la société bourgeoise est l’aboutissement parfait de l’aliénation millénaire, et l’idée complémentaire d’une révolution qui mettrait simplement fin à cette aliénation achevée. Courte vue, besoin d’imposer le repos au cours des choses, de nier l’imprévisible.
Extrait de la post-face
« Une telle amitié exige qu’on se lise dans ce que l’on lit – que littéralement on s’y trouve – par le mouvement même de cette
« communication de blessure à blessure » dont on a vu qu’elle faisait le sens même du « communisme métaphysique » de Mascolo. Chaque blessure est irréductiblement singulière, dont le trajet destine, et la communauté des hommes blessés ne saurait reposer sur l’affirmation d’une propriété partagée, se donnerait-elle pour minoritaire. On les connaît, ces sujets blessés qui n’ont jamais été aussi pleins d’eux-mêmes que depuis qu’ils ont décidé de se répandre à l’envi sur leur meurtrissure. La blessure dit la dépossession, au contraire, que rien ne viendra consoler dans l’illusion d’une identité retrouvée. Se trouver dans et par la lecture d’un autre, c’est reconnaître qu’avoir le besoin en partage ne consiste jamais à se retrouver. La communauté du refus est toujours négative, comme le refus lui-même, dans la mesure où rien ne viendra définir a priori ce qui manque à chacun et qui le fait être celui qu’il est insubstituablement. Il est donc possible d’en dire ce que Mascolo lui-même reconnaissait en 1968 au Comité d’action étudiants-écrivains : « Toute autorité perdue, cela va sans dire, mais aussi tout savoir, et même toute certitude, toute sécurité, puisqu’il s’identifie au mouvement collectif d’un refus agissant, qui est à la fois l’affirmation d’un manque et la recherche de ce qui appartient encore à l’inconnu : c’est l’exigence révolutionnaire illimitée ». C’est à cette communauté que Je suis ce qui me manqueappelle ceux qui sauront s’y trouver, depuis la profondeur de leur propre blessure, d’où seulement l’écoute est possible. Appel sans fin – sans achèvement ni but –, comme est sans fin le mouvement communiste rapporté au refus qui l’anime. « Le communisme : ce qui exclut (et s’exclut de) toute communauté déjà constituée, dira Blanchot en 1968. La classe prolétarienne, communauté sans autre dénominateur commun que la pénurie, l’insatisfaction, le manque en tous sens » (« Le communisme sans héritage »). Charme d’un tel communisme, si l’on tient, avec Mascolo, que « le charme ressemble à une disposition de l’être tout entier à la communication » – sa grâce essentielle, dont les carnets nous suggèrent qu’elle est « toujours associée à quelque chose d’inconsolable ». « C’est précisément ce qu’il garde d’inconsolé qui fait le charme principal d’un être », dit-il dans De l’amour – cette grâce qu’auront partagée tous ceux que le communisme a traversés comme le mouvement même de leur vie dans le libre essor d’une « exigence révolutionnaire illimitée ».