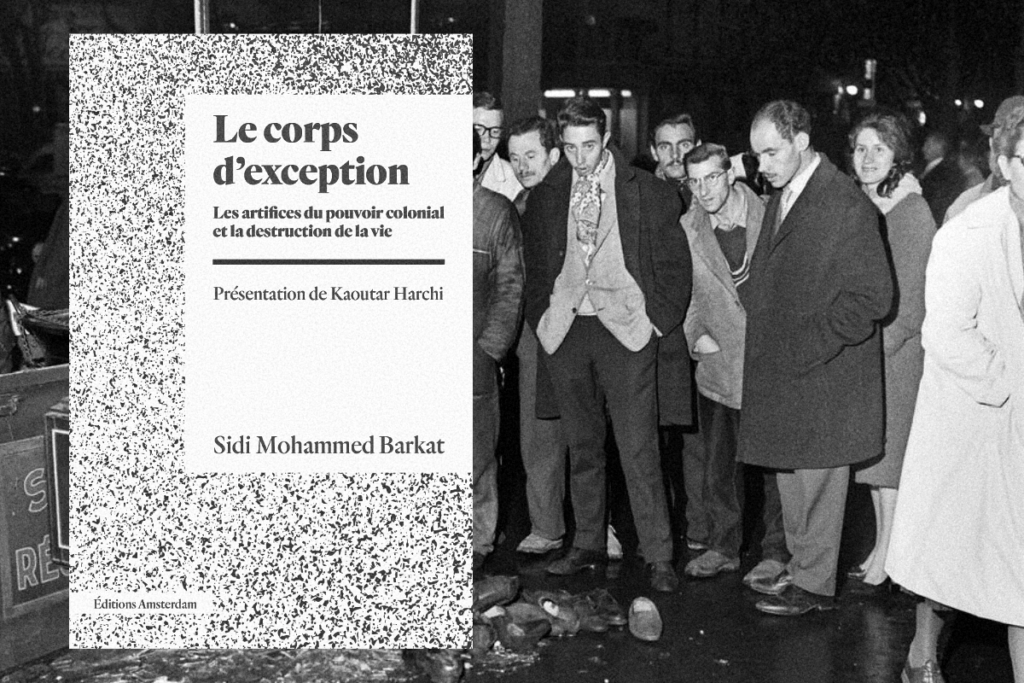Après avoir été longtemps occultée, la manifestation des Algériens de la Région parisienne protestant contre le couvre-feu pris à l’encontre des « Français musulmans d’Algérie », est maintenant largement documentée. La répression policière à laquelle elle a donné lieu est passablement connue du grand public[1], reconnue et condamnée par la souveraineté nationale[2]. En imputant la responsabilité de la répression et de son déni par la Préfecture de Police au préfet Maurice Papon, le texte de cette motion escamote pourtant une question ou, plutôt, suggère une réponse interdisant de poser la question : comment la violence d’une telle répression a-t-elle été possible ? Et une autre, qui n’est pas déliée de la première, loin s’en faut : comment la décision d’un couvre-feu circonscrit à une partie de la population française, qualifiée selon son appartenance religieuse, circonscrite par l’État en communauté distincte du reste du peuple, tout en maintenant son inclusion au sein de ce peuple même, a-t-elle pu être prise ? La question ne relève pas du droit de la guerre ou d’une stratégie policière du maintien de l’ordre. Dans la première hypothèse, il eut fallu reconnaître les Algériens comme un État en guerre contre un autre, ce que l’État français déniait. Dans la seconde, elle reste ouverte : à quelle condition était-il pensable de pouvoir circonscrire une communauté au sein de la population, sans contradiction du point de vue du droit positif ? Ce qui engage notre interrogation : comment la violence de cette répression, quantitativement (les historiens dénombrent entre 200 et 300 morts) aussi bien que dans sa forme (la plupart des victimes furent retrouvées noyées dans la Seine) a-t-elle été possible ? Quelle structure mentale a disposé les agents de l’ordre et leur donneur d’ordre à une haine d’une telle virulence face à une foule d’hommes et de femmes désarmés ? Et la même question se pose face aux massacres, toujours aussi mal connus du public français, de Sétif et Constantine en mai 1945, au moment même où la France joyeuse célébrait la victoire sur les nazis ? Et toujours largement ignoré du public, le massacre de Tirailleurs « sénégalais » à Thiaroye au Sénégal en décembre 1944. Et puis, recouvert encore d’un silence gêné, voire stipendié comme forme détestable de haine de soi si ce n’est de trahison nationale, malgré les aveux de certains tortionnaires, l’usage systématique de la torture durant cette « guerre sans nom »[3] et sa conséquence se faisant sentir jusqu’à aujourd’hui, celle des « disparus »[4], sans oublier ce qui est toujours recouvert de voiles, la pratique systématique, dès avant le début de la guerre, du viol des femmes, mais aussi des hommes lors des séances de tortures[5]. Ces questions ne peuvent se résoudre par la seule analyse historienne des causes factuelles : interrogeant les conditions qui rendent possibles des conduites, elles ne peuvent se résoudre que par l’élaboration d’un concept philosophique qui permette non pas d’expliquer tel enchaînement causal (le rapport des forces entre le FLN et l’armée française, les négociations politiques engagées entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire algérien, la stratégie politique des deux camps, etc.), ni de glorifier ou de se repentir,[6] mais de comprendre pourquoi tel type de décisions et d’actes (le couvre-feu restreint aux « Français musulmans », la protestation contre cette mesure, la violence de la répression) a pu être pris et conduit, à comprendre pourquoi des sujets humains ont pu trouver raisonnable de se conduire ainsi. Non pas en raison d’une éternelle nature humaine, ni d’une hypothétique psychologie des peuples, mais d’une configuration historiquement définie de leur mode de penser. Prendre la question sous cet angle, qui n’invalide en rien l’enquête historienne sur les causes conjoncturelles portant sur les faits, c’est se situer dans le temps long de l’histoire, celui qui permet non pas les assimilations de situations différentes (l’indigénat existe toujours, identique à lui-même), mais les comparaisons faisant apparaître différences et invariants (qu’est-ce qui, dans l’invention étatique de l’indigène rend pensable telle conduite à distance de l’instauration du code lui-même).
Tel est l’objet que se proposait, en 2005, le livre aujourd’hui heureusement réédité, de Sidi Mohammed Barkat, Le corps d’exception. Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie[7]. La réponse tient dans l’élaboration et la mise en œuvre de son concept de « corps d’exception ». Concernant le fait dont nous sommes partis, la manifestation du 17 octobre :
Quand le 17 octobre 1961 le préfet de police de Paris décide de s’opposer au déploiement de la manifestation des Algériens, ses troupes perçoivent aisément dans les ordres donnés et les discours tenus qu’elles doivent se mobiliser contre des corps d’exception. Elles pourront alors agir en dehors des règles générales du droit sans que cela ne trouble les consciences. Ce qui explique la facilité avec laquelle des policiers se transforment en agents d’une terreur d’État mobilisés contre des dizaines de milliers de manifestants pacifiques, ce n’est donc pas seulement le contexte particulier de la France de l’époque où la police s’oppose régulièrement aux groupes armés du Front de libération national algérien, mais bien le fait que des Algériens, en tant que masse indifférenciée, sont depuis longtemps considérés comme des corps d’exception (p. 143-144).
Que faut-il entendre par « corps d’exception » ? Le concept trouve son origine, mais non son fondement, dans le sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Il stipule en son article 1 : « L’indigène musulman est Français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane » ; l’article 2 dit de même pour « l’indigène israélite » qui « continuera à être régi par son statut personnel »[8]. La complexité du dispositif idéologico-politique est masquée sous l’apparente simplicité d’une donnée factuelle : il y aurait des « indigènes » là, sur cette terre, que l’article défini singulier unifie en masse homogène, distingués selon leur religion, islam ou judaïsme, factualité à prendre en compte par l’État impérial, et puis des colons qui arrivent et s’en distinguent, alors que la terre est intégrée à l’ensemble de l’Empire. Toutes les apparences d’une reconnaissance de la diversité culturelle, à l’encontre d’une colonisation cherchant à convertir pour assimiler. Réellement, le décret étatique invente « l’indigène » en l’assignant à une « religion » de laquelle il ne peut sortir, sauf par un geste individuel qui le rendrait digne de la citoyenneté, de la jouissance des droits politiques à égalité avec les autres citoyens français. La racialisation de la religion, déniée un temps, réapparaît ici : cette assimilation a un statut personnel, elle n’est pas transmissible aux descendants de celui qui a renoncé au statut juridique de musulman pour le droit civil commun. Ils restent et resteront des « indigènes » ayant à prouver individuellement leur capacité à la citoyenneté, suspects d’être encore et toujours pris dans les rets de leur religion, laquelle est incompatible par nature avec les « valeurs de la République », pour faire usage d’un anachronisme, avec la civilisation dont la destinée est la sécularisation. Racialisation se dévoilant dans cette notion juridique paradoxale qu’est celle de « musulman catholique », désignant le musulman converti au catholicisme, selon un arrêt rendu par le tribunal d’Alger le 15 novembre 1903, mais relevant encore du « droit coranique ». « Aux yeux du droit, la religion n’est pas une option que l’indigène serait en mesure de choisir[9] » : « c’est l’idée que le statut personnel de “droit musulman” auquel restent indéfectiblement attachés les colonisés est porteur de facteurs culturels responsables d’un comportement non conforme à la morale et à la raison » (p. 79). Ainsi l’État impérial et républicain développe-t-il un « racisme sans race »[10], distinguant au sein de la nation des communautés définies par « la religion », ce en contradiction avec le principe de sécularisation, puis celui de laïcité.
S. M. Barkat y voit une contradiction avec le principe républicain de l’égalité entre les citoyens, fondé sur celui de l’égalité naturelle entre humains : « L’institution de l’indigène soustrait en premier lieu la question de la constitution du corps souverain à la problématique de l’égalité issue de la Révolution française et l’inscrit dans le champ culturel des filiations. » (p. 40) Pourtant cette entorse au principe de l’égalité n’est pas propre au droit colonial : elle est rendue possible avec celui-ci par l’invention d’un monstre juridique, la « citoyenneté passive » promulguée par la Constituante de 1789 associant la citoyenneté de plein exercice au paiement d’un cens (p. 128). Ainsi, très vite, l’égalité affichée comme principe a-t-elle été renvoyée à l’horizon d’un avenir de progrès, toujours reculé. De même, c’est cette idéologie de l’histoire comme progrès qui invite le colonisé à se départir de ses caractères particuliers pour être éduqué à la civilisation, fondée sur l’idéologie des peuples enfants, voire des peuples sans histoire ou, dans une lignée vaguement hégélienne, de peuples passant à côté de l’histoire.
Comme le montre M. A. Meziane, reprenant longuement l’analyse des textes d’Ismaÿl Urbain, l’inspirateur du sénatus-consulte, quinze ans après Barkat, ce racisme se fonde sur le thème de la perfectibilité de l’indigène, déployant « un concept de la race saisie comme une disposition à évoluer d’une manière irréductible »[11], assignant l’islam à l’impératif de sécularisation dont l’Europe occidentale donne le modèle.
C’est ainsi qu’un corps collectif est circonscrit, inclus au sein du peuple, de la nation en tant qu’il est exclu des droits politiques fondamentaux, dont les membres sont soumis « à un régime juridique d’exception » (p. 123), permanent. La singularité de la domination coloniale, en regard de ce que fut la citoyenneté passive, tient à ce que ce corps collectif inscrit ses stigmates dans le corps de chacun des individus qui le composent, à l’instar de ce qui caractérise cet autre « racisme sans race » qu’est l’antisémitisme, véritable matrice de ce dispositif. Ambivalence du concept de « corps d’exception » : un corps collectif inclus et soustrait du peuple compris comme corps politique et des corps individuels marqués comme appartenant à ce corps collectif sur lesquels peut s’exercer la violence de leur assignation au groupe et celle de la répression policière au cas où il chercherait à en sortir :
Le colonisé est […] un individu résidant sur le territoire français, artificiellement classé puis rangé à l’extérieur de l’ensemble composant les membres du souverain, régis quant à eux par les règles générales du droit. En ce sens, il n’est pas à vrai dire un corps extérieur. Sa situation est une situation de dépendance, plus complexe donc que celle de la simple extériorité. Le corps d’exception, enveloppe instituée qui recouvre tout un groupe que l’on n’admet pas dans la citoyenneté et auquel on attribue de manière arbitraire une homogénéité ethnique ou raciale (le statut personnel joue le rôle d’un opérateur de conversion permettant de réduire de façon imaginaire l’ensemble des colonisés à une seule entité), est encore un membre de la nation française. En effet, ce corps considéré comme indigne de la citoyenneté possède la qualité de Français, de sorte qu’il est contenu dans cette société, inclus en tant que non compté, inclus en tant qu’exclu (p. 125).
Dans un vocabulaire proche, j’ai appelé ceci l’inclusion exclusive[12], renvoyant à un dispositif analysé par Carl Schmitt, selon lequel un peuple tend à intégrer en son sein de l’hétérogène pour faire valoir son homogénéité : « Colonies, protectorats, mandats, traités d’intervention et autres formes de dépendance permettent aujourd’hui à une démocratie de dominer une population hétérogène sans en faire des citoyens, de les rendre dépendants de l’État démocratique et pourtant de les tenir simultanément éloignés de l’État[13]. »
Parce qu’il s’agit d’un concept philosophique, le « corps d’exception » rend possible une réflexion comparative : comparaison, mais non identification. Ainsi, publié en septembre 2005, le livre précède de peu les révoltes des banlieues faisant suite à la mort de Zyed Benna et Moussa Traoré, cherchant à fuir la police, – corps soupçonnés de quels méfaits ? –, corps déterminés à se méfier de ceux des policiers par une expérience fixée en manière d’être. Et puis « la vague de tristesse [qui], aujourd’hui encore, ne s’est pas retirée, n’a guère emporté, et n’emportera jamais avec elle, l’incompréhension, la colère. C’est une vague, une lame de fond, un raz de marée que nombre d’entre nous ont affronté. C’est former une communauté d’expérience. Et toute personne qui fut écrasée par cette affliction appartient à cette communauté. Et tel un oubli impossible, l’oubli refusé, nous parlons de Zyed Benna et de Bouna Traouré »[14]. Comme le dit Kaoutar Harchi, « quelque chose recommençait »[15], quelque chose, pas tout à l’identique, mais quelque chose de l’histoire se perpétuait et rendait possible cette résurgence du droit colonial que fut l’instauration de l’état d’exception inventé pour la guerre d’Algérie et appliqué aux banlieues populaires, rendu possible par ce socle idéologique qui est pensé ici sous le concept de « corps d’exception » : la mise en exception du droit commun de corps dont l’apparence physique est censée exprimer un retard sur la capacité morale du reste de la nation, soit « le partage désormais interne entre un “nous” sécurisant et un “eux” peu fiable ne suppos[ant] aucun conflit véritable, mais seulement la protection juridique, administrative et policière de cette séparation » (p. 81). C’est ce socle idéologique, ayant pris forme juridique avec le sénatus-consulte, qui perdure d’autant plus que le mode de la décolonisation en Algérie a procédé d’un déni, comme le montre, peu après la première édition du livre de Barkat, l’historien Tod Shepard[16]
Relire ou lire aujourd’hui ce texte invite aussi à reprendre la réflexion sur le « communautarisme » ou le « séparatisme » dont l’islam, donc les musulmans sont suspects, incapables culturellement d’adhérer aux « valeurs de la république ». Il s’agirait en effet de comprendre comment l’assignation du musulman à une religion déclarée incompatible avec de telles « valeurs » est un dispositif visant à construire un peuple homogène, « culturellement porté à la vie morale » (p. 54), devant se protéger des risques que lui fait courir « celui qu’on ne saurait accueillir alors qu’il est déjà là ». Il s’agirait de tracer le lien qui se tisse entre ce présupposé colonial persistant, la transformation de la laïcité de principe juridique de l’État en « valeur » à laquelle le citoyen est sommé d’adhérer et sa reprise par l’extrême droite comme flambeau d’une identité française qui doit se parer contre les risques de sa dénaturation par le retour vindicatif de l’ancien colonisé. Écrit en 2005, le livre de Barkat ne contient pas les réponses à ces questions : l’élaboration du concept de « corps d’exception » rend possible leur mise en chantier, parce qu’il rend raison « de cette croyance : parmi les membres de la nation, il y a ceux qui lui seraient originellement liés et en seraient les membres authentiques – ce sont les garants de son intégrité – et puis les autres, dont le lien est construit et donc artificiel, non essentiel, ceux qui sont susceptibles de lui porter atteinte de l’intérieur » (p. 36).
Gérard Bras
Le Corps d’exception.
Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie.
Sidi Mohammed Barkat
Présentation de Kaoutar Harchi
Éditions Amsterdam, 2024
152 pages, 11 €.
[1] Voir, récemment l’émouvante exposition que la bibliothèque La Contemporaine a consacré au photographe Elie Kagan et la nuit du 17 octobre 1961 : http://www.lacontemporaine.fr/203-dossiers/zoom-sur/413-zoom-sur-le-17-oct-1961.
[2] Compte-rendu des débats à l’Assemblée nationale, séance du 28 mars 2024 sur une résolution reconnaissant et condamnant « le massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris » : https://lcp.fr/actualites/l-assemblee-nationale-reconnait-et-condamne-le-massacre-des-algeriens-du-17-octobre-1961#:~:text=La%20r%C3%A9solution%20%22condamne%20la%20r%C3%A9pression,Papon%20le%2017%20octobre%201961%22.
[3] Titre d’un film de Bertrand Tavernier et Patrick Rotman produit en 1992.
[4][4] L’expérience des morts de cette guerre est massivement une expérience de la disparition des corps qui fait obstacle aux commémorations nécessaires pour apporter de l’ordre dans la confusion créée par la guerre. L’expression du deuil et les commémorations effectives des martyrs qui naissent en 1962 et demeurent puissantes aujourd’hui sont marquées par cette mort comme disparition. » Malika Rahal, Algérie 1962. Une histoire populaire, Paris La Découverte, 2022, p. 199.
[5] Florence Baugé, intervention à la Journée d’études à l’Assemblée nationale, « Les disparus de la guerre d’Algérie du fait des forces de l’ordre françaises : vérité et justice ? », 20 septembre 2019, cité par Nicolas Lambert, La France Empire, édition Un pas de côté, Paris 2024.
[6] Pensons au principe « ni maudire, ni se moquer mais comprendre », attribué à Spinoza.
[7] Édtions Amsterdam, Paris, 2005 et 2024, avec une présentation de Kaoutar Harchi. On peut se demander quel étrange oubli conduit l’éditeur comme la présentatrice a ne pas mentionner le fait de la réédition : un texte est toujours daté, même quand il vise une vérité éternelle.
[8] https://mjp.univ-perp.fr/france/sc1865-0714.htm.
[9] Mohamad Amer Meziane, Des empires sous la terre. Histoire écologique et raciale de la sécularisation, Paris, La Découverte, 2021, p. 112.
[10] Etienne Balibar et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, Le Découverte 1988, p. 36-37.
[11] M. A. Meziane, op. cit., p. 167.
[12] Gérard Bras, Les voies du peuple. Éléments d’une histoire conceptuelle, Paris, éditions Amsterdam, 2018.
[13] Carl Schmitt, Parlementarisme et démocratie, Le Seuil, Paris 1988, p.107.
[14] Kaoutar Harchi, Comme nous existons, Arles, Actes Sud, 2021, p. 111-112. Ce sont les pages qui suivent qu’il faudrait citer tout entières.
[15] Ibid, p. 109.
[16] « Le consensus formé autour du “courant de l’Histoire” a permis de confondre les choix politiques des autorités françaises avec les “valeurs républicaines” (liberté, égalité, fraternité, droits de l’homme) tout en dissociant les institutions républicaines de ce que la France avait fait en Algérie. Une France sans l’Algérie était le signe de la victoire indiscutable des valeurs républicaines, et non pas la preuve que la mise en œuvre de valeurs fondées sur l’universalisme, leur institutionnalisation par les républiques successives, n’avait été possible qu’en privant de ses droits une partie de la population : en l’occurrence les “musulmans”. » Tod Shepard, 1962. Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2012 [2008], p. 444.