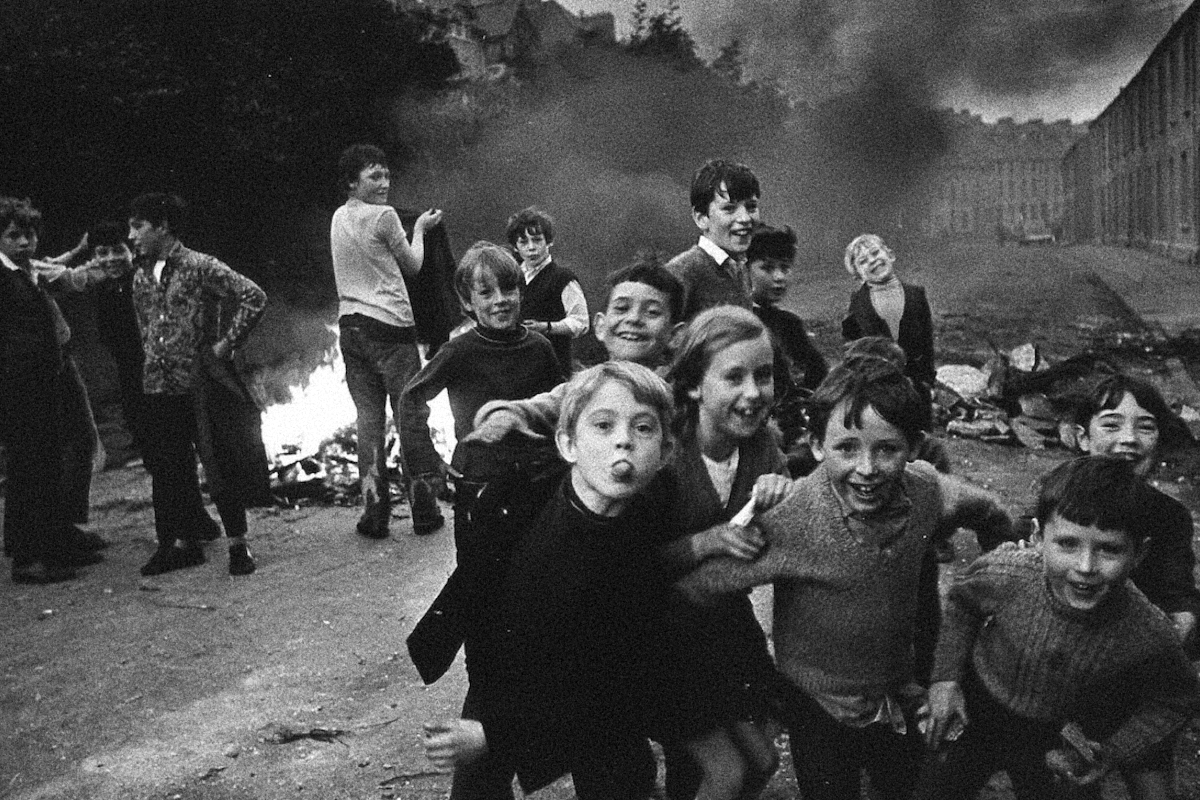Ce texte constitue l’épilogue à la traduction castillane de Il n’y a pas de révolution malheureuse de Marcello Tarì, publiée sous le titre No existe revolución infeliz. El comunismo de la destitución aux éditions Petit 14 en avril 2025.
Nul mouvement dialectique, nulle analyse des constitutions et de leur sol transcendantal ne peut apporter de secours pour penser une telle expérience ou même l’accès à cette expérience.
Michel Foucault, « Préface à la transgression »
1. Désormais disponible en espagnol, Il n’y a pas de révolution malheureuse. Le communisme de la destitution offre aux lectrices et lecteurs, anciens et nouveaux, l’une des expositions les plus percutantes de cette chance révolutionnaire que nous connaissons sous le nom de puissance destituante. Huit ans après sa publication originale, il s’est consolidé comme l’un des principaux condensateurs discursifs contribuant à franchir le seuil de notre époque, manifestant la vérité non comme justification de ce monde, mais comme une force qui lui est hostile : « Le monde existant tout entier n’est-il pas privé de vérité ? Le monde tel qu’il existe n’est pas vrai » (Bloch).
Dans le cadre d’une stratégie philosophique et politique au sens le plus strict, la première formulation explicite du concept de puissance destituante (puissance, non pouvoir) est liée à Giorgio Agamben. Entre 2013 et 2014, dans une série de variations qui clôturent son archéologie de la politique occidentale – les quatre volumes du projet Homo sacer –, Agamben présente la puissance destituante comme une « figure différente de la politique ».[1] Différente en quel sens ? En ce qu’elle ne met pas en marche les opérations, les mécanismes ni les paradigmes qui, selon cette archéologie, ont été décisifs – et catastrophiques – dans l’histoire de la politique occidentale (« l’Occident » ne désigne pas, dans le discours destituant, simplement une entité géographique ou culturelle, mais une structure opératoire constituée par des processus d’exclusion et d’inclusion, de capture et de gestion de la vie). Ainsi, la puissance destituante se dessine d’abord comme une rupture avec le continent ou le territoire de la politique occidentale : une discontinuité qui singularise et rend possibles d’autres domaines, d’autres choix, d’autres concepts et d’autres objets du politique. Autrement dit, cette figure différente de la politique parle à la fois de la disparition d’une positivité – l’ensemble des conditions d’existence qui ouvrent et définissent un champ de phénomènes et de problèmes possibles – et de l’émergence d’une autre. Il ne suffit donc pas de considérer le concept de puissance destituante comme une élaboration intellectuelle isolée (l’attribuer exclusivement à un « auteur » serait insuffisant), ni comme un simple épisode dans l’histoire des idées. Il faut plutôt le saisir à hauteur de sa positivité, comme un condensateur monadique d’une problématique générale différente, dont le terrain autonome rend possibles d’autres questions (de la politique, de la culture, de l’être, du langage, de l’humain et du non-humain, etc.).
Que l’histoire de la problématique destituante soit discontinue par rapport à la tradition politique de l’Occident (et, avec elle, à son ontologie, son esthétique, son anthropologie, etc.) implique logiquement qu’elle ne peut être comprise comme une suite progressive de « corrections » apportées aux concepts ou aux institutions de ladite politique, ni comme une contradiction interne à un processus continu orienté vers une synthèse ou une réconciliation finale. En d’autres termes, il n’y a pas de dialectique reliant ces deux territoires ou continents ; entre eux, il n’existe ni analogie ni même ressemblance : la puissance destituante se manifeste comme hétérogène aux présupposés de la politique occidentale. Cette discontinuité et cette hétérogénéité déterminent un point essentiel de la stratégie destituante, sans lequel il est impossible de comprendre sa place et sa portée par rapport aux problèmes et débats de notre présent. Au contraire, lorsqu’on l’analyse de l’intérieur de la tradition politique occidentale, les interprétations dominantes se réduisent à une lecture en négatif, centrée exclusivement sur ce qui est perdu, abandonné ou épuisé. Ainsi, sa formulation stratégique se trouve confinée au manque, à l’étrangeté ou à l’insuffisance : depuis un point de vue extérieur, ses questions n’ont pas de sens.
À ce stade, Frédéric Lordon et Roberto Esposito incarnent l’impuissance intellectuelle de ceux qui demeurent prisonniers des dispositifs circulaires de la critique et de la dialectique. Leur attachement à ce qui est destitué (l’état de choses existant, colonisé par la mesure comptable monétaire et la rationalité économico-gestionnaire) condamne leurs critiques à une valorisation des rendements ou effets (l’« efficacité ») qu’une stratégie politique devrait produire. Mettre en œuvre la logique destituante est ainsi perçu comme insensé, dénué de valeur ou inutile, puisque cela ne constitue ni n’institue rien, ne propose ni solutions ni alternatives, ne traduit pas le possible en réalité, n’organise pas de sujet révolutionnaire, ne réimagine ni ne reconstruit les bases de « notre organisation politique et sociale », etc. Tenter de comprendre la stratégie destituante à l’intérieur de tout système de pensée politique et ontologique traditionnel est voué à l’échec, puisqu’elle abrite quelque chose de totalement différent qui ne peut être saisi, pour ainsi dire, que depuis le dehors de ces systèmes et de leurs délimitations.
2. Il n’y a pas de révolution malheureuse se distingue parmi un groupe d’écrits destituants qualifiables de stratégiques, car ils priorisent les objectifs tactiques d’une stratégie de lutte. Ce sont, en outre, des exposés qui ont contribué à une explicitation positive de la problématique destituante, renforçant l’autonomie de son terrain politique et de ses pratiques. Dans ces textes, la problématique destituante n’est pas simplement commentée ou expliquée de façon exhaustive : on en fait usage, on la met en acte et on l’expérimente comme stratégie révolutionnaire contre les États capitalistes contemporains, la gestion économique mondiale, les relations marchandes, les régimes d’exception et, parmi d’autres, les dispositifs de contrôle. Une mention nécessaire parmi ces écrits est la traduction stratégique rapide de la problématique destituante réalisée dans À nos amis, le deuxième essai philosophico-politique du comité invisible, publié en 2014. Dans ce texte, la puissance destituante est en première ligne comme ce qui rend sensible la question stratégique de la révolution, tout en défiant l’ensemble des stratégies et des artifices élaborés contre elle :
Parti d’Argentine, le mot d’ordre « Que se vayan todos ! » a bel et bien fait trembler les têtes dirigeants du monde entier. On ne compte plus le nombre de langues dans lesquelles nous avons crié, dans les dernières années, notre désir de destituer les pouvoirs en place. Le plus surprenant est encore que l’on y soit, dans plusieurs cas, parvenus. Mais quelle que soit la fragilité des régimes succédant à de telles « révolutions », la deuxième partie du slogan, « Y que no quede ni uno solo ! » – « Et qu’il n’en reste aucun ! » –, est restée lettre morte : de nouveaux pantins ont pris la place laissée vacante.
L’idée, toujours d’actualité, est la suivante : les pouvoirs constituants et les imaginaires instituants projettent leur ombre non seulement sur ceux qui œuvrent au maintien de l’existant, mais aussi sur ceux qui finissent par reproduire exactement ce qu’ils prétendaient subvertir. Jusqu’à présent, le parti de l’insurrection n’a pas été capable d’élaborer les forces nécessaires pour rompre « la dialectique incessante, inépuisable et désesperée, entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, violence qui pose le droit et violence qui le conserve » (Agamben). C’est à travers ce cycle infini d’alternances, de « changements » et de déceptions imminentes que se perpétue la continuité infernale de l’état de choses existant, malgré – ou à cause de – crises permanentes, routines post-historiques de plus en plus frivoles, avancées militarisées du nihilisme et catastrophes esthétisées à tous les niveaux. Un règne policier de la normalité et une citoyenneté envoûtée par des chimères gouvernementales – « il faut défendre la société » – sont quelques-uns des dispositifs chargés d’une rétention katéchontique des dynamiques destituantes de la révolte. Travaillisme, syndicalisme, militantisme, autogestionnisme, démocratisme, activisme, biopolitisme, entre autres, sont quelques versions historiques des capteurs et agents de neutralisation qui canalisent le destituant vers de nouvelles figures du pouvoir. Suivant l’avertissement de Mario Tronti, il n’est pas justifié de parler d’une défaite au plan social lorsqu’il s’agit de ces mouvements constituants ; cependant, sur le terrain politique, on peut parler d’une défaite : l’échec de la révolution.
De manière analogue, les destins tragiques du Printemps arabe ont servi, dans les écrits d’Agamben et du comité invisible, de cas paradigmatique de l’échec révolutionnaire contemporain. À partir de ces événements, ils ont identifié que le principal obstacle à la destitution du pouvoir a été, jusqu’à présent, la capture de mille machines de guerre par d’anciens ou nouveaux appareils d’État : « Immédiatement, on a fait des assemblées constituantes et ça a été suivi par quelque chose de pire que ce qu’il y avait avant. Et le nouveau pouvoir constitué qui s’est mis en place par ce mécanisme diabolique du pouvoir constituant, est devenu un pouvoir constitué » (Agamben). À cet exemple s’ajoutent d’autres cas récents de défaite politique illustrant ce renouvellement cyclique du pouvoir, nourri par la fiction du pouvoir constituant : l’explosion sociale au Chili entre 2019 et 2020, les protestations à Hong Kong entre 2019 et 2021, et les mobilisations en Colombie en 2021. Inspirés par la prétention dogmatique d’un progrès sans fin, les processus constituants s’alignent complètement sur la même tendance à étrangler les possibilités d’une véritable discontinuité révolutionnaire. Dans leur désir d’instaurer un novus ordo sæclorum, les protestations citoyennes partagent le même rêve : atteindre leurs objectifs et leurs revendications sans recourir à des conatus destituants.
3. Il n’y a pas de révolution malheureuse explore l’hypothèse selon laquelle mettre fin au pouvoir constituant équivaut à mettre un terme à la tragédie de la révolution. Dans cette perspective, il approfondit une stratégie révolutionnaire où le geste destituant ne se réduit pas à un moment d’un mouvement constituant supposément plus général – comme le dicte le schéma de la politique moderne et sa recherche insatiable d’une source séculier ou « légitime » de souveraineté –, mais s’expérimente comme le mouvement en soi. Ainsi se dessine une problématique révolutionnaire rompant avec toute représentation juridique du politique, celle qui présuppose l’existence d’un pouvoir constituant derrière l’état de choses existant. Ce pouvoir constituant, dont la présupposition légitime les opérations des pouvoirs en place, n’existe plus nulle part (s’il a jamais existé). L’état de choses existant, avec ses édifices étatique, juridique et institutionnel, repose exclusivement sur la violence pragmatique des ordres et des décrets : un gouvernement des vivants et des choses opérant en marge d’un fondement dans l’être, un être-en-vigueur sans signification qui ne peut se passer de l’état d’exception, de la police et du contrôle cybernético-paranoïaque pour continuer à durer. Dans cette perspective, nous ne pouvons qu’insister sur les mots de Benjamin et Pasolini : la société capitaliste est anarchos, sans fondement ni principe.
Alors que les négristes et d’autres secteurs de la citoyenneté mondiale tentent par tous les moyens de maintenir vivante la notion de pouvoir constituant et la représentation juridique du politique, cherchant à instaurer un fondement solide garantissant l’opérativité anarchique d’un « gouvernement civil », nous, les destituants, soutenons que le pouvoir constituant n’est rien d’autre qu’un dispositif conçu pour capturer la vie politique. Sa fausseté se révèle dans chaque conflit où il apparaît clairement que notre vie politique ne fait face qu’à un pouvoir constitué : la police, en dernier ressort. En réalité, le mythologème du pouvoir constituant a toujours eu la fonction scénique de perpétuer la servitude volontaire devant la violence souveraine, en introyectant en chaque individu la mauvaise conscience du sujet souverain : « De plus, celui qui tente de déposer son souverain et est puni ou exécuté pour cette tentative, est l’auteur de sa propre punition, puisque, par l’institution même, il est l’auteur de tout ce que son souverain fait » (Hobbes). Seule une vie nue, aseptisée ou épurée de toute intensité conflictuelle, peut continuer à vénérer le pouvoir constituant et ses idéaux régulateurs – la « société civile », la « représentation politique », les « institutions démocratiques », l’« État de droit », le « sujet révolutionnaire », etc. –, tandis que l’expansion hypertróphique des appareils administratifs et le durcissement mortifère de l’état d’exception mondial progressent sans frein. L’élaboration collective d’une stratégie destituante dans la réflexion et la praxis révolutionnaire exige une intelligence partagée de cette situation, où l’état d’exception mondial se manifeste comme une guerre civile mondiale.
4. Une autre remarque sur l’effondrement de la représentation juridique du pouvoir et l’émergence historiquement située d’une stratégie destituante : le monde de la marchandise autoritaire et son tissu continu de normes et dispositifs – l’Empire ou le Capitalisme Mondial Intégré – renforcent leur force matérielle par le pouvoir armé, avec une méga-industrie nationale et transnationale (armement, extraction, pharmacie, divertissement, entre autres) qui se coordonne indistinctement avec des forces légales et extralégales pour reconfigurer à sa guise les Constitutions de toutes les nations. À l’époque contemporaine et dans son économie de guerre, les fictions modernes du peuple et de la volonté générale sont agitées uniquement par des dupeurs, des ventriloques d’une novlangue qui laisse intact l’ordre des choses : « révoltes de sujets et d’identités », « agoras numériques », « contre-pouvoirs, contre-dispositifs, contre… », « multitudes circonstancielles », « révocations symboliques », « réappropriation collective de la richesse », « habiter la métropole », « nouvelle époque historique à venir », « sphère publique non étatique », « biopolitique inflationniste », et autres semblables. Sous la domination réelle de la marchandise et du spectacle, il ne reste que le public et son opinion, pilotée en dernier ressort par les intérêts privés de ceux qui contrôlent ces entreprises capitalistes que sont les médias de masse. Sous cet angle, le diagnostic humaniste – et a fortiori moderne – d’une obsolescence de l’homme trouve son corrélat inévitable dans l’obsolescence du citoyen. L’idéologie démocratique est telle parce qu’elle réprime l’adémie constitutive du monde historique dans lequel nous vivons. « Ne crois pas avoir des droits » n’est pas, en ce sens, une dénonciation indignée ni une déclaration de défaite, mais un énonce du communisme de la destitution qui rend sensible la conflictualité historique : nous sommes en guerre.
5. Depuis sa formalisation explicite, la stratégie destituante a suivi une trajectoire largement souterraine, se propageant dans des conversations informelles, des luttes concrètes et des territoires habités en marge des projecteurs du spectacle ou des scènes métropolitaines. Cependant, comme tout ce qui est ingouvernable et inapproriable, le destituant avait déjà peuplé son propre plan de consistance bien avant d’être nommé en tant que tel : dans les logiques centrifuges de dispersion, dans la déviation imprévisible du clinamen, dans la dimension transindividuelle de l’être, dans la rupture avec le pouvoir terrestre et ses institutions, dans l’omnia sunt communia, dans les fuites vers la montagne, dans la décréation opérée par la créature elle-même, dans la violence purement révolutionnaire, dans le refus absolu et sans phrases, dans l’aire de l’Autonomie, dans l’obstination à la différenciation, entre autres. Il n’existe pas de révolution malheureuse offre une analyse prolifique de certains de ces processus, positions et situations destituantes, mettant en lumière des exemples historiques que quelconque peut actualiser comme forme-de-vie, comme exercice d’une éthique révolutionnaire. Une tâche complémentaire à ce type de travaux serait d’entreprendre une archéologie qui situe historiquement sa positivité spécifique, c’est-à-dire ses conditions de formation ou ce qui l’a rendue possible à une époque donnée. Cela implique aussi d’analyser une problématique théorique et une constellation de pratiques qui, durant une période donnée, ont franchi des seuils décisifs (de formalisation, d’expérimentation, de radicalisation, de confrontation, etc.). Quels schémas du politique ont été dépassés ou transgressés pour que la problématique destituante devienne époqualement possible ? Quelles conditions historiques ont érodé la centralité de la souveraineté et de la représentation en tant que formes privilégiées du politique ? Quelles ruptures dans la grammaire de la militance et de la subjectivité politique ont permis de penser la révolution non comme un projet de gouvernement, mais comme une forme de désappropriation, d’exil extatique ou de communisme sans œuvre ? La réponse à cette question permettra de comprendre sa discontinuité et son autonomie face à d’autres problématiques, comme la problématique métaphysique du sujet et de la constitution première, qui imprègne tous les contenus du discours constituant et l’imaginaire instituant.
Outre Il n’existe pas de révolution malheureuse, toute archéologie du destituant doit prendre en compte le troisième et dernier livre du comité invisible, Maintenant (2016). Si l’on examine son titre original – Destitution ! – il devient encore plus évident la place centrale que cette logique occupe dans les assauts révolutionnaires contre l’économie époquale qui nous enferme. Une autre contribution importante est Habiter contre la métropole, un livre rédigé au Mexique en 2018 par le conseil nocturne, qui aborde la stratégie destituante depuis la primauté des territoires existentiels et du « être-en-situation ». Indépendamment des dates de publication, un même geste lie et partage ces textes : la pratique d’un communisme de pensée, cette activité intellectuelle de groupe que Dionys Mascolo qualifiait de « l’un des seuls correctifs visibles de la prodigieuse impuissance de l’esprit dans le monde ». La culture de cette conspiration se reflète non seulement dans la problématique explorée – la stratégie destituante comme composante du communisme qui vient –, mais aussi dans la récurrence, dans les trois livres mentionnés, d’une même traduction bâtarde de la définition du communisme dans L’idéologie allemande, définition qui, malgré sa large citation, reste encore inexplorée ou piétinée : « Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt » – « Nous appelons communisme le mouvement réel qui destitue l’état de choses existant ».
6. Quelles ruptures, transformations et déplacements de problématiques provoque la traduction – ou la trahison – du verbe allemand aufheben par « destituer » ? Dans le passage immédiatement précédent la définition du communisme, Marx et Engels affirment : « Pour nous, le communisme n’est pas un état de choses à produire, un idéal vers lequel la réalité devrait tendre. » Par ces mots, ils se situent violemment en dehors et au-delà de la culture métaphysique occidentale, expérimentant et exerçant un autre plan de phénoménalité : un plan qui accompagne les assauts de la discontinuité révolutionnaire et l’habiter d’autres géographies. En se mouvant sur un autre plan, l’agir n’obéit pas à des fins dernières ni à des idéaux transcendants : « Le juste ne cherche rien dans ses œuvres ; car ceux qui cherchent quelque chose dans leurs œuvres et agissent en vue de quelque “pourquoi” sont des serfs et des mercenaires » (Maître Eckhart). Il s’agit d’une « politique des moyens purs » ou d’une « ontologie de l’immanence », matrice d’un communisme sans égards pour les utopies futures ni pour leurs programmes. Nicola Massimo De Feo a reconnu cette rupture et a souligné, dans le passage d’Engels et Marx, un des moments-clés de la tradition révolutionnaire où l’expérience du communisme converge avec la critique antichrétienne, antibourgeoise et antisocial-démocrate de Nietzsche : une volonté de puissance qui lutte pour enterrer tout idole métaphysique persistante, tout arrière-monde érigé pour entraver l’expérimentation hic et nunc d’une forme-de-vie.
Car chrétiens, bourgeois et sociaux-démocrates sont tous les gradualismes, tous les étapismes, tous les programmes « qui, au nom d’un avenir meilleur, prolongent le passé oppressif par une productivité exploiteuse » (Marcuse). En ce sens, toute militance ou praxis politique concevant la réalité comme un processus de réalisation – qu’il s’agisse d’une essence, d’un programme, d’une tâche, d’une finalité, d’un avenir, etc. – reste prise dans cette même logique. Dans la mesure où elle demeure capturée par le paradigme métaphysique de la réalisation, la béatitude de cette vie se projette vers le futur ou se déplace aux cieux, condamnant à l’échec toute tentative de recherche de bonheur sur terre : « Je sais, certes, que ce désir ne peut être réalisé aujourd’hui ; ni même, la révolution aurait-elle lieu demain, se réaliser intégralement de mon vivant. […] Si j’étais né dans une société communiste, le bonheur m’eût-il été plus facile » (Castoriadis). La compréhension de l’agir comme réalisation – et le devoir correspondant de traduire quelque chose en réalité – repose exclusivement sur une logique de délai infini et de progrès incessant, propre à un culte capitaliste aspirant à durer éternellement. Cet horizon subordonne l’agir à une opération incessante ou « mise-en-œuvre » de ce qui, supposément, n’est pas réel ou ne l’est pas encore : « Nous continuons à tâtonner dans la praxis cette passage vers le nord-ouest, ce portail où le possible se traduit magiquement ou laborieusement en réalité et où la politique trouve sa réalisation définitive. Cette passage n’existe pas, car le possible est déjà réel et, en tant que tel, est absolument irréalisable » (Agamben). Rien de plus erroné, de ce point de vue, que la critique mesquine d’Arendt envers Marx qui, selon elle, aurait confondu – en simple tribut au pensée politique moderne – la question stratégique de la révolution avec un problème de poïesis, c’est-à-dire de production et manipulation de l’existant (et ses corollaires : réification du monde, optimisation des instruments, planification sur le vivant, obsession de la performance, etc.). Au contraire, la conception immanente du communisme de la destitution rejette gouvernants et gouvernés, planificateurs et exécutants, programmes et œuvres. De là, la nullification communiste de la société divisée en classes englobe aussi la démolition de toutes les scissions et oppositions dialectiques sur lesquelles repose le pouvoir de ce type de société, « car la multiplicité dépasse dès le début toute opposition, et destitue le mouvement dialectique » (Deleuze et Guattari).
Pour reprendre la définition d’Engels et Marx, le communisme qui vient n’est pas un mouvement de réalisation, mais, dès l’origine, un mouvement réel et, par conséquent, irréalisable : wirkliche Bewegung. Ce qui est en jeu ici est une transformation radicale de la conception dominante de l’être : l’expérience de la Wirklichkeit ou réalité, dans une société sans classes, se manifeste toujours comme un être-en-œuvre, une pleine demeure dans la présence. Dans ce cadre, il n’y a pas de « scission, et en même temps coopération, entre l’activité et l’initiative nécessaires du militant politique, d’une part, et les lois dialectiques de l’histoire qui garantissent son efficacité, d’autre part » (Agamben). Une puissance destituante, donc, ignore la division métaphysique entre possible et réel, entre puissance et acte, entre essence et existence, entre moyen et fin. Par conséquent, elle rejette dès la racine tout chef, gestionnaire ou programme aspirant à organiser le passage du règne de la nécessité au règne de la liberté. Comme un compagnon l’a exprimé il y a quelques années, dans les dynamiques extatiques d’une puissance destituante il n’existe pas le pseudoproblème de la « transition vers le communisme » : la transition est, en elle-même, la catégorie du communisme, du communisme en tant qu’expérimentation. La prolifération du communisme est acéphale, dans la mesure où un prolétariat ayant déposé toute tête – toute cabeza –, tout Capital, assume comme unique et paradoxique vocation – la vocation messianique – de se révoquer lui-même comme prolétariat et de s’expérimenter enfin comme forme-de-vie.
7. Dans une interview de 2022 sur la traduction en anglais de Il n’existe pas de révolution malheureuse, Marcello Tarì affirme : « Notre tâche serait donc désormais de séparer la pensée et la pratique de la révolution de leurs origines modernes et occidentales, et donc aussi du marxisme. Si nous restons idéologiquement liés aux origines occidentales du concept de révolution, nous n’aboutirons nulle part. » La logique destituante, dans son désir de faire voler en éclats le continuum de l’histoire, inspire ce mouvement réel qu’est le communisme et assume la tâche de révolutionner le concept même de révolution. Tant que la révolution sera conçue comme un acte constituant donnant naissance à un nouvel ordre ou produisant un état de choses, nous resterons piégés dans l’économie infinie du monde et soumis à la domination de ses forces productives. Sous cet horizon, seules peuvent persister les questions ironiques du Capitaine Insurgé Marcos, posées dans l’un de ses communiqués de 2024 : « Changement avec continuité ? Encore la même chose ? ».
L’une des principales contributions que Il n’existe pas de révolution malheureuse offre à ce renouvellement de la reflexión et de la praxis révolutionnaire est l’accent mis sur la transformation radicale du « soi » et de « l’intime ». Il s’agit d’une éthique entendue comme transformation radicale des relations du soi – avec soi-même, avec les autres et avec le monde –, ce qui coïncide avec l’élaboration collective d’une forme-de-vie. Par une forme-de-vie, toutes les questions inhérentes à la fiction moderne et occidentale de l’individu isolé sont déplacées. Avec la consolidation du nomosbiopolitique de la planète, la distinction entre dispositifs de gouvernement et sujets a perdu de sa pertinence, rendant inutile la conception du pouvoir comme une entité réifiée et séparée, comme un ensemble « d’appareils » pouvant être saisis et manipulés comme des outils ou des armes. C’est seulement depuis cette zone d’indifférence entre les techniques de gouvernement et les processus de subjectivation dans les sociétés contemporaines (la constitution d’un tissu biopolitique continu) qu’on comprend pourquoi, dès sa naissance, le biopouvoir a concentré son action non seulement sur la colonisation des relations avec autrui, mais aussi sur les relations du soi avec lui-même. Dans cette colonisation originaire résident à la fois le premier pas et l’aboutissement final d’une occupation capitaliste des relations interhumaines et extrahumaines. Hors de cette problématisation, rien n’est plus naturel qu’une esthétisation ou une dépolitisation des dernières généalogies de Foucault sur le dispositif de la sexualité ou l’éthique du souci de soi. C’est dans une perspective proche que Marcello Tarì souligne, dans la même interview, que « le concept de puissance destituante n’a de sens et d’utilité que s’il n’est pas seulement considéré comme relevant de la dépossession des pouvoirs externes – gouvernements, États, normes, lois, etc. – mais aussi comme une puissance qui transforme également les relations personnelles avec soi-même, entre soi et les autres, et avec le monde ».
Habiter notre propre « soi » comme lutte destituante et anti-coloniale, placer au centre de la révolution la question de comment nous vivons là où nous vivons, et court-circuiter les modes de perception et d’auto-perception au service des dominateurs (et de soi-même comme gouvernant de soi-même), sont, dans leur ensemble, des mesures anti-biopolitiques essentielles pour l’insurrection qui vient – qui est toujours déjà en train d’advenir. Ce n’est qu’à travers ces processus destituants qu’il est possible d’entrevoir les possibilités révolutionnaires de forger une intimité plus forte que la métropole.
Mexico, mars 2025
Alan Cruz
[1] La première version a été présentée lors du séminaire « Défaire l’Occident », qui s’est tenu du 27 juillet au 3 août 2013 sur le plateau de Millevaches, en France : Giorgio Agamben, « Vers une théorie de la puissance destituante», dans lundimatin, n° 45, 25 janvier 2016, https://lundi.am/vers-une-theorie-de-la-puissance-destituante-par-giorgio-agamben ; trad. cast.: « Hacia una teoría de la potencia destituyente », dans Artillería immanente, 15 juin 2016, https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=308 (cette traduction contient également un compte rendu complet de chaque version).