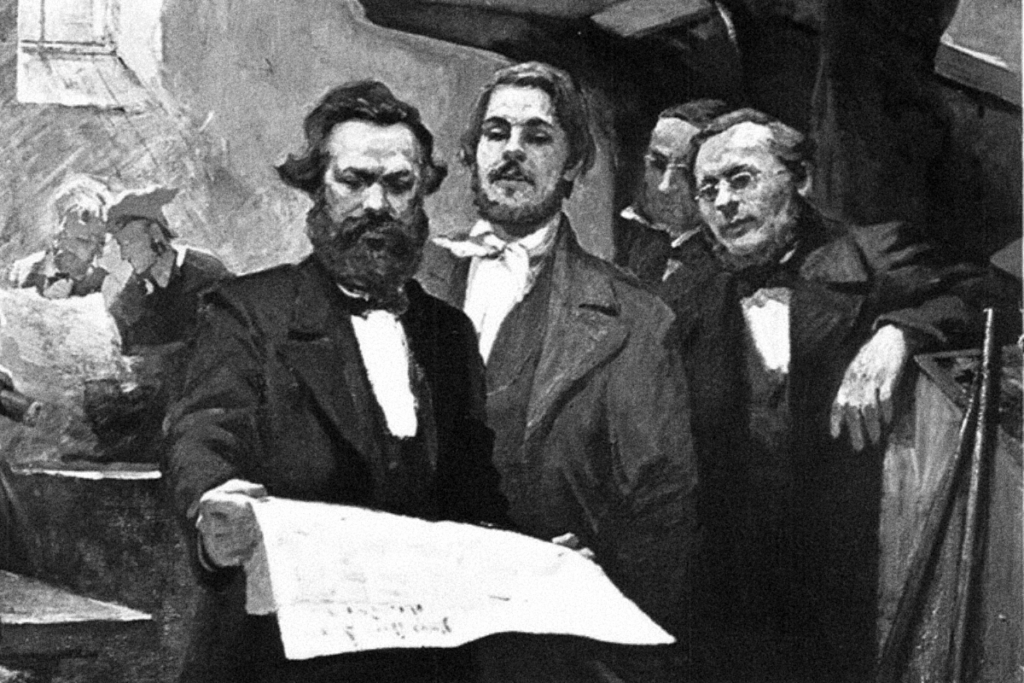« Notre force est tout entière dans cette certitude : nous n’avons pas d’avenir à vendre, seulement un présent à jouer. Ce sont les curés qui vendent de l’avenir. »
Jean-Paul Michel, La politique mise à nue par ses célibataires mêmes
« De qui n’entend pas succomber même à la terrible hantise de sa propre impuissance, et de celui-là seulement, il y a encore tout à attendre, et en premier lieu le dépassement de l’impuissance. »
Giorgio Cesarano, Ce que taire ne se peut
Mon intervention part de la question « est-ce la fin de la politique ? ». Je crois qu’une telle question traduit une inquiétude qui s’impose à tous ceux et celles qui évoluent dans un milieu qui se réclame d’une tradition dite révolutionnaire ou radicale. Cette inquiétude est indubitablement liée à l’impossibilité de ne pas reconnaître qu’une totalisation du monde a bel et bien eu lieu par le capital, que celle-ci se poursuit et que ses dernières mutations ont produit une « crise de l’objectivité » à laquelle personne ne semble échapper. Par crise de l’objectivité, je veux dire deux choses. Premièrement que la totalisation du monde par le capital s’expérimente trop régulièrement par ses sujets comme non-vraie, par conséquent la mobilisation à son égard s’avère de plus en plus difficile. Deuxièmement, toutes les extériorités modernes à la totalité sur lesquelles étaient formulés les différents projets révolutionnaires du XIXe et XXe siècle, le travail, la valeur d’usage, la crise économique, le prolétariat, la nature, etc., ont perdu leur qualité d’extériorité. La discussion sur leur capacité à saisir la réalité a structuré le débat révolutionnaire. Aujourd’hui, et depuis cinquante ans, ce même débat perd de plus en plus sa raison d’être à cause de ce que Cesarano appelait déjà en 1973 le développement d’un capital autocritique. En d’autres termes, la publicité au lieu de se voir attaquée par et depuis une infrapublicité a englobé cette dernière. Cela signifie qu’on ne peut que très difficilement relancer un tel débat, et ceci même en questionnant les fondements d’une tradition à laquelle nous revendiquerions une appartenance. En effet, pour le faire, nous sommes de plus en plus acculés aux cadres d’un débat public. Ce dernier, implique une valorisation permanente de l’ego ou de l’identité dans laquelle on croit se reconnaître. Son contenu est prédéfini par une spéculation sur l’attente des spectateurs ou par les « prédictions » des algorithmes. Le révolutionnaire ne se retrouve alors pas plus différent que tout un chacun dans ce monde. Soit il botte en touche, il se sent urgemment poussé à l’action tout en étant convaincu de la vanité de son geste. Paniqué par cet entre-deux douloureux, il devient à la merci de toutes les gouvernances. Il peut à la rigueur tenter de sortir de la panique en théorisant son retrait. Par-là, il n’est pas si différent de tous les alternatifs, des New Ages, ou de ce qui se joue derrière le « quiet quitting ». Soit il se convertit à la dernière forme de vie du capital : le joueur. Le joueur ne croit en rien si ce n’est qu’en ses propres capitaux qu’il cherche à faire fructifier autant que possible. Sa contradiction réside dans le fait qu’il doit nécessairement supposer ce qu’il nie, à savoir une ou plusieurs totalités dans lesquelles de tels capitaux peuvent s’échanger, circuler, etc., et que chacun joue au même jeu que lui, bien que ce soit un jeu à somme nulle. Pour lui l’action ou l’inaction, ne se réduisent qu’à des stratégies plus ou moins efficaces à l’accroissement de sa richesse au détriment des autres.
Ainsi, La question : « est-ce la fin de la politique ? » témoigne bien d’une inquiétude, celle qui ne veut ni céder à la panique, ni prétendre sortir de ce monde abstraitement, ni se convertir à l’ultime forme de vie du capital. Pour tenter d’y répondre, j’essaierai de la traduire par trois autres questions, à la fois théoriques et existentielles : « la révolution est-elle encore possible ? », « si oui, une activité politique peut-elle encore être publique ? » et « puis-je espérer apparaître, à moi-même et aux autres, à partir d’une existence principalement définie par la politique ? »
I. La révolution est-elle encore possible ?
a. Si vous me le permettez, j’aimerais ici essayer de comprendre la notion de révolution telle que Jacob Taubes la comprend. Il la considère comme une apocalyptique, une transformation du monde dans sa totalité, le remplacement d’un monde par un autre et la révélation d’un tel processus. Cette politique apocalyptique implique à la fois une destruction de l’existant et la construction d’autre chose. Depuis Marx, on associe un tel mouvement à celui du prolétariat. Il ne fait pourtant aucun doute que le monde ouvrier a échoué à s’imposer contre celui du capital, ceci depuis les années 1920. En réalité, la seule occurrence historique d’un remplacement d’un ou plusieurs mondes par un autre correspond au processus même du capital. En effet, au cours de son développement, le capital n’a eu de cesse de saper l’ensemble des présuppositions qui lui ont donné naissance pour les remplacer par des fondements qui lui sont propres et aux prétentions universelles. Ces derniers sont sans arrêt remis en cause par le mouvement du capital, de sorte qu’il devient cette puissance apocalyptique, à la fois destructrice et constructrice. Depuis quelques années, le remplacement lent et difficile de l’économie en écologie, le déploiement de technologies de plus en plus invisibles, duales et omniprésentes ainsi que l’accumulation de situations qui favorisent une potentielle guerre mondiale sont, par exemple, les éléments qui permettent de saisir la nouvelle tendance révolutionnaire du capital. Il se débarrasse de la séparation classique entre nature et culture tout en continuant un anéantissement du surnuméraire. Du point de vue du capital, l’au-delà correspond avec le désastre. Son eschatologie est donc purement négative, car l’actualisation de cet au-delà n’existe que pour éterniser le monde de l’ici. Le procès du capital peut donc être vu comme la révélation d’une révolution permanente, où sont à la fois institués la destruction du monde et son maintien.
Ce processus révolutionnaire, cette eschatologie, est le fruit de politiques, c’est-à-dire des stratégies d’organisation de la vie par plusieurs fractions du capital qui tantôt s’allient, tantôt s’opposent. Il n’y a là rien d’automatique et il n’y a pas de plan net du capital. Dans ce sens, ce n’est pas la fin de la politique. La mise en mouvement généralisée, à laquelle parfois nous participons, c’est-à-dire cette disposition à la disponibilité, n’est jamais sans rapport à l’annonce du désastre. Toutes les pratiques politiques, qui se donnent à voir dans l’espace public, même contestataires, même celles qui refusent l’organisation de la vie par les fractions du capital, se mobilisent au nom d’une telle annonce. Car seule la référence à une telle annonce les rend légitimes, leur donne une raison, une impression de concrétude. Ils ne peuvent pas se passer d’une telle légitimité, car le remplacement des mondes par la totalité du capital a produit un contexte partagé par tous, communs, une humanité à laquelle il est devenu inaudible de se détacher. Par-là, la politique se montre dans son aspect le plus mobilisateur, dans son caractère cultuel. Nous confondons le scénario apocalyptique du capital – la possibilité objective de la fin du monde par les limites terrestres et une nouvelle guerre mondiale – avec l’apocalypse de notre temps : la révélation d’un capital révolutionnaire comme seule transcendance expérimentable sincèrement, non pas comme nouvelle vérité, mais comme effective. Se poser la question « est-ce la fin de la politique ? » témoigne donc de deux choses : d’une part de la difficulté à considérer une pratique politique en dehors de l’urgence imposée par les scénarios des fractions du capital et, d’autre part, de la difficulté à envisager une politique non eschatologique dès lors que l’apocalypse est réalisée par le processus même qu’il s’agissait traditionnellement d’abattre. Tout ceci nous force alors à distinguer deux types de politique, l’une eschatologique qui a été historiquement incapable d’invoquer l’autre monde auquel elle se référait pour refuser l’ici-bas, et qui désormais, pour se maintenir, ne peut qu’accepter l’autre monde invoqué et réalisé par le capital. La seconde, qui me semble difficilement nommable encore aujourd’hui, est avant tout une politique de l’expérience. Elle prend racine dans le but qu’elle se donne, non pas donc depuis un autre monde, mais uniquement « depuis la vie de l’éphémère », depuis, donc, une attention à ce qui est ici. Comme attention, elle trouve ses raisons d’abord dans le présent. Mais celui-ci est éclairé par le passé, non pas comme quelque chose de donné, qu’il faudrait conserver ou retrouver, mais comme quelque chose à conquérir, qui ne se lasse pas d’être redéfini et qui n’existe qu’en rapport à ce qui vit. Du futur, ou de l’ailleurs, elle ne peut rien espérer, elle n’envisage que le pire, pour le conjurer au présent, et trouver de la joie. Elle reconnaît donc dans la vérité du processus de totalisation, une objectivité qui s’impose à tous, mais une objectivité purement négative à laquelle nulle ne peut réellement prétendre.
2. Abandonner l’espace public ?
J’ai donc commencé à répondre à la question « est-ce la fin de la politique ? » Pourtant, ma réponse à la question « la révolution est-elle encore possible ? » n’est pas claire. Rien ne dit que la politique de l’expérience soit une politique révolutionnaire, du moins pas pour le moment. Cette non-réponse, c’est-à-dire la réponse qui propose : la révolution a été réalisée et continue d’être réalisée par le capital, est absolument insatisfaisante pour le désir présent de communisme comme pour tous ceux qui eurent par le passé la passion de changer le monde.
Je crois que nous traversons un moment, où une telle question ne peut pas recevoir de réponse claire dans un espace public. Non pas parce que la révolution serait ce « dont on ne saurait parler », mais parce qu’elle n’est plus quelque chose capable d’être saisie dans la sphère de la publicité. Ce n’est pas quelque chose qui peut s’énoncer dans un espace où l’on se représente face aux autres ou à soi-même.
La publicité s’est historiquement construite comme le lieu d’exercice d’un contre-pouvoir de la bourgeoisie vis-à-vis de l’aristocratie. Elle est l’espace où l’ensemble des personnes privées, qui forment un public, s’adressent au pouvoir et les unes aux autres. Elle est consubstantielle à la création du marché et à l’aliénation de l’échange par lui. Elle a prétendu, et ceci souvent avec une certaine efficacité, être le lieu de construction d’une critique du pouvoir au nom d’un intérêt général, de l’universel. Par-là, elle a dû, au fur et à mesure de l’histoire, inclure un ensemble toujours plus élargi des populations sur lesquelles le pouvoir s’exerce. En réalité, il me semble important de reconnaître que l’universel a toujours été la représentation polie et hypocrite du désir d’un intérêt particulier à subsumer les autres. Aujourd’hui, l’espace public jouit encore d’un tel prestige, bien qu’il apparaisse d’une manière de plus en plus évidente à tous comme le règne de la manipulation. Toutefois, il ne se limite plus à la presse, aux discussions du Parlement, aux moyens d’expression que possède le pouvoir de l’État, ou même aux mass medias. La Publicité est devenue l’intégralité de la vie quotidienne qui se donne à voir comme politique. Sa seule manière de se maintenir comme l’espace hégémonique d’expression de l’intégralité de la parole des êtres humains réside dans la transformation de la courtoisie en un immense amas de cynisme. Tous ceux qui n’en jouent pas le jeu en seront, peu à peu, exclus. Maintenir la question de la révolution dans un tel espace c’est donc avant toute chose s’apparaître à soi et aux autres comme révolutionnaire, alors même que ce qui, dans ce cadre, l’est ne peut être que le capital.
En réalité, la question de la révolution, que ce soit depuis le fascisme en Italie et en Allemagne ou le Front populaire en France, a été bannie de la Publicité. Cela fait donc quasiment cent ans qu’elle n’existe plus au sein de cet espace. 1968 et les années qui suivirent en Italie fut la tentative la plus aboutie d’un retour de cette question dans l’espace public. Cette dernière tentative était basée sur une critique au nom d’un universel, meilleur que celui justement proposé par le capital. Aujourd’hui, la crise de l’objectivité que nous traversons se traduit justement par l’impossibilité de continuer à se référer positivement à l’universel, ce qui implique une disjonction totale de l’activité politique – qui ne soit pas une activité politique eschatologique – d’avec la sphère publique. La seule chose qu’il reste à faire, c’est d’organiser la rencontre.
Il faut dire que la notion de rencontre est devenue une sorte de mot de passe. Avec mes amis, elle nous apparaît comme une solution au marasme, à l’hypocrisie et au cynisme. Elle devient cet événement à notre portée, réalisable, hors de toute prétention publicitaire. Elle est ce qui déborde des rapports imposés et ce qui, ici, ouvre à du possible sans utopie, elle nous renforce. La rencontre est donc un point de départ réaliste. Et, ce réalisme provient justement d’une clairvoyance non seulement sur notre propre impuissance, mais aussi sur notre besoin, notre désir de ne pas s’y complaire. Cette nécessité de la rencontre fait d’autant plus sens que depuis les politiques sanitaires de 2020, la séparation qui apparaissait généralement comme une conséquence des processus de réification s’est vue être quelque chose de sciemment organisé planétairement.
Toutefois, on peut déjà déceler un certain « solutionnisme » dans la mystique de la rencontre, car la rencontre devient souvent le maigre butin impartageable des aléas de la vie. On ne saurait l’organiser telles des managers qui cherchent à faire du team building, ou des agences matrimoniales. À ce titre, la Chine comme la ville de Tokyo ont créé leurs propres applications de rencontres en 2023 et 2024, tandis qu’on entend en France et en Allemagne quelques voix proposer un ministère de l’amitié. Plus comiquement, la rencontre est aussi ce qui donne, dans nos propres défaites, l’ultime raison de ne pas remettre en question le redoublement du monde auquel nous venons de participer : puisqu’au moins « nous y avons fait des rencontres ». Si la politique de l’expérience correspond stratégiquement à une politique de la rencontre, deux choses sont à mettre au travail :
a. La première est une définition négative de l’organisation de la rencontre, ce qu’elle ne peut pas être si elle ne veut pas participer du dédoublement du monde. L’organisation de la rencontre ne peut pas chercher à recréer dans un cadre plus restreint une publicité alternative à la publicité. Elle ne peut pas être un débat parallèle au débat sur l’universel dont l’objet serait un alteruniversel. Car le concept même d’universel implique une lutte contre tout autre concept d’universel. En se donnant pour but de redéfinir mieux que ne le fait le capital une telle notion, elle entrera, qu’elle le veuille ou non, en concurrence avec la publicité officielle. Au final, elle ne serait qu’un espace de construction d’une contre-hégémonie à l’hégémonie actuelle. Elle n’aurait de fin que dans le remplacement de celle contre laquelle elle veut exister. Pour cela elle ne pourra manquer de s’y faire représenter, et nous reviendrons donc une nouvelle fois à la politique révolutionnaire eschatologique, et ceci d’une manière d’autant plus ridicule que personne n’aurait la force de concurrencer réellement la Publicité officielle. Plus encore, l’organisation de la rencontre ne peut pas être une alterpublicité parce que comme espace public « underground » elle donne une géographie, une dimension, où des expériences négatives du monde peuvent être capitalisées. Elle crée une extension du marché où chaque être devient un joueur en puissance et chaque corps un capital aux multiples potentialités. Le désir d’en être, la valorisation de soi et le transfert des capitaux longuement construits dans un milieu vers un autre moins radical sont chose courante dont il me semble important de se passer. La question qui reste en suspens : comment ne pas faire cela ?
b. Une manière peut être de commencer à y répondre c’est en établissant une distinction au sein même de la stratégie de l’organisation de la rencontre entre une bonne et une mauvaise rencontre. En d’autres termes : toute rencontre n’est pas bonne à faire. Il ne s’agit donc pas d’organiser n’importe quoi avec n’importe qui. Deleuze, dans son Spinoza Philosophie pratique nous indique peut-être un chemin à prendre. « Sera dit bon (ou libre ou raisonnable, ou fort) celui qui s’efforce, autant qu’il est en lui, d’organiser les rencontres, de s’unir à ce qui convient avec sa nature, de composer son rapport avec des rapports combinables, et par là d’augmenter sa puissance. Car la bonté est affaire de dynamisme, de puissance, et de composition de puissances. Sera dit mauvais, ou esclave ou faible, ou insensé, celui qui vit au hasard des rencontres, se contente d’en subir les effets quitte à gémir et à accuser chaque fois que l’effet subi se montre contraire et lui révèle sa propre impuissance. Car, à force de rencontrer n’importe quoi sous n’importe quel rapport, croyant qu’on s’en tirera toujours avec beaucoup de violence ou un peu de ruse, comment ne pas faire plus de mauvaises rencontres que de bonnes ? Comment ne pas se détruire soi-même à force de culpabilité, et ne pas détruire les autres à force de ressentiment, propageant partout sa propre impuissance et son propre esclavage, sa propre maladie, ses propres indigestions, ses toxines et poisons ? On ne sait même plus se rencontrer soi-même. »
Si l’on résume cette citation, grossièrement, la différence entre celui qui fait de bonnes rencontres et celui qui en fait des mauvaises tient au fait que le premier existe de telle sorte qu’il a d’abord pris le temps d’analyser non seulement la composition chimique du monde dans lequel il se meut, mais aussi la sienne.
Ainsi, se poser la question d’une bonne rencontre implique de ne pas lier nécessairement l’organisation de la rencontre à la constitution immédiate d’un groupe ou d’un collectif comme nous avons coutume de le faire. Il s’agit en réalité d’établir (ou d’écouter) chez chacun, mais d’abord chez soi – comme corps –, une capacité qui pourrait se définir comme un art de la distinction et de la distance entre ce qui est bon ou mauvais pour soi, comme un examen de nos affections et de notre propre pouvoir d’affecter. Et, je dis « écouter chez soi », car il me semble que l’incapacité à dire « je » dans nos milieux est généralement là où toutes les attentes se prennent des murs. Par refus du libéralisme, nous nous sommes aveuglés à la construction des egos, qui disparaîtraient magiquement dès lors qu’un groupe ou un collectif se crée. Je pense que c’est une erreur. Dit autrement, l’organisation de la rencontre, comme agir politique, exige de subsumer la politique à une éthologie, c’est-à-dire de rendre possible la rencontre entre choses qui se conviennent. Cela implique qu’il n’y a rien à espérer de la rencontre. Elle est bonne ou mauvaise en soi, elle augmente ou diminue notre puissance, elle donne force ou non à l’éternité de ce qu’on pourrait appeler une forme de vie. L’organisation de la rencontre, c’est l’élaboration lente et patiente d’un langage commun, différent de celui du capital, qui fait sens non pas de lui-même, mais du fait de l’expérience de son élaboration. La recherche de la vérité n’a donc plus de sens relatif à une autre, hégémonique, mais par rapport à la construction même de rapports entre des êtres. Il peut donc y avoir plusieurs vérités, sans que celles-ci cherchent nécessairement à détruire les autres, à les subsumer.
La révolutionne peut donc plus apparaître sur l’espace public si ce n’est que comme une destruction de celui-ci. Comme destruction, elle est l’établissement d’un plan d’immanence, celui des formes de vie. Pour le dire autrement : la révolution n’est que le moment de transformation de la publicité en guerre civile. Ce n’est donc pas une eschatologie, car la guerre civile, comme le dit Tiqqun, ne porte pas sur un advenir, mais sur ce qui est déjà là. Dit autrement, la révolution reste, mais il n’y a rien de plus foireux que la tentative désespérée d’ériger une « forme de vie révolutionnaire ».
3. Paradoxalement, s’il s’agit peut-être de commencer par soi – sans jamais prendre cela pour une fin politique – il ne peut donc pas s’agir de charger la totalité de son existence d’une signification politique. La question de la fin de la politique témoigne de cette ultime inquiétude du militant, du citoyen ou même du militant de mauvaise foi (c’est-à-dire le militant qui milite depuis la critique du militantisme) qui a besoin d’une réponse immédiate à la question millénariste « pourquoi suis-je ici ? » Pour autant, si on suit ce que je viens de dire plus haut, à partir de la subsomption réelle du capital sur la société, la Publicité congrue avec la vie quotidienne. De ce fait, tout apparaît enfin comme politique, mais ne peut être reconnu comme tel que par la médiation eschatologique de l’annonce de la fin de la politique, car une telle congruence n’est possible qu’à partir des différents scénarios apocalyptiques produits par le mouvement du capital. Un basculement s’opère donc, le constat angoissant de la médiation totalitaire de chaque relation par ce mouvement subjectivise chaque individu dans l’expression biface d’une morale universelle où tantôt tout doit être politique, tantôt rien ne doit plus l’être. On retrouve ainsi ici premièrement le sujet paniqué qui dans l’activisme ou le retrait est gouverné et, deuxièmement, le joueur qui prétend se gouverner lui-même vis-à-vis des autres dans un monde où toute relation est subsumée à une théorie des jeux.
A contrario, une politique de l’expérience ne peut plus se permettre une existence publique, elle est forcée à une certaine clandestinité, ou plutôt à une certaine méfiance. Si sa stratégie est bel et bien celle de l’organisation de la rencontre, alors elle ne peut pas présupposer la politique sur le mode d’un devoir-être. Peut-être faut-il donc abandonner la mythologie situationniste de la cohérence parfaite entre l’activité politique et l’existence quotidienne. Une telle recherche de cohérence a d’ailleurs été la source constante d’une insatisfaction généralisée de toutes les individualités qui peuplent les milieux radicaux. Cela n’implique absolument pas de pas maintenir une critique de la vie quotidienne, de ne pas être dupe sur les jeux sociaux dans lesquels nous sommes pris, ni d’accepter tous les compromis. Cette distinction est à la fois théorique et stratégique, pour que l’organisation des rencontres ne soit pas l’organisation des mauvaises rencontres.
Théoriquement, une forme de vie qui serait purement politique s’identifie facilement avec celle du capital, comme lui, elle prétendrait avoir un sens en dehors de son propre contexte, une forme de vie donc qui en elle-même décèle une prétention à l’universalité de sa forme, par-là elle reste invariablement enfermée dans l’esclave qui ne peut que faire de mauvaises rencontres. Ces formes de vie que le capital a, à la fois, produites et, sur lesquelles, il appuie pour sa propre reproduction, peuvent être comprise comme l’élaboration concrète de l’humanité. L’absolutisation de l’individu comme une abstraction vide de sens hors du contexte de la totalité formée par l’ensemble des autres individus sur la planète. C’est la forme de vie « humaine ». L’incapacité à se saisir soi-même, seul ou avec d’autres, en dehors d’un contexte de totalisation, correspond à l’adhésion bon gré mal gré, à une formulation d’une politique insidieusement eschatologique.
Enfin stratégiquement, et je terminerai par cela, la disjonction d’avec la sphère publique est une question de sécurité. Le cynisme avec lequel l’époque nous apparaît maintenant ne va pas tarder à remettre en question l’ensemble des présupposés démocratiques libéraux qui protégeaient relativement tous ceux qui proféraient des discours dits révolutionnaires. La politique de l’expérience et sa stratégie de la rencontre n’ont pas besoin de s’exprimer publiquement, par contre elles ne peuvent accepter l’immobilité et la solitude, la tristesse de se retrouver de plus en plus acculées à accepter et à pâtir de ce monde. Elles ne peuvent donc mettre en péril ce qui, dans un contexte encore un peu libéral, reste possible : se déplacer pour rencontrer ceux et celles avec qui il y aurait encore quelque chose à se dire, avec qui une rencontre est possible. Finalement, la disjonction de la politique avec l’espace publique permet peut-être d’accroître les possibilités de bonnes rencontres, car l’objet de toute éthologie ne pourra plus tellement s’illusionner des discours et des intentions proférées en public, mais prendra de plus en plus pour objet ce qui est véritablement fait.
Mohand
Ce texte est issu d’une intervention aux rencontres du Non Kongress, à Berlin, les 21 et 23 juin 2024 : https://nonkongress.noblogs.org