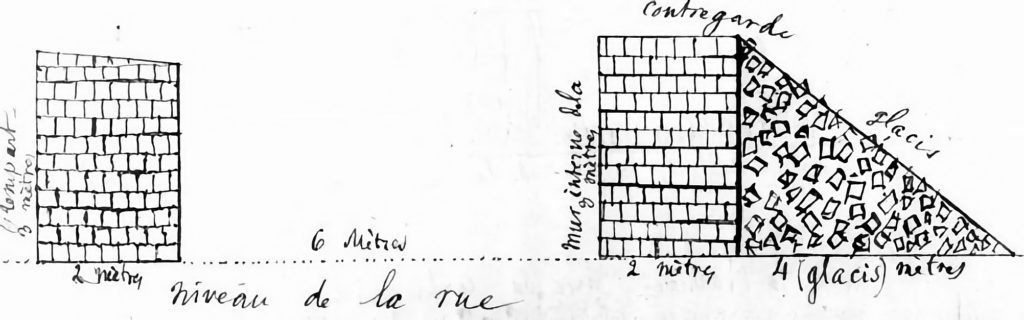Aiguiser un point de vue révolutionnaire pour attaquer le présent, c’est l’horizon. Prendre la parole dans un débat qui n’existe pas encore, entrer dans un banc de brouillard et en ressortir avec un abécédaire. Les années écoulées ont dévasté les dernières certitudes fragiles qui tenaient encore la politique révolutionnaire en place. Quelques tentatives et lueurs ont indiqué des chemins, mais tout autour on tâtonne dans l’obscurité. Pour sortir de cette obscurité, il faut d’abord être au milieu d’elle, la mettre en lumière. À force de tâtonnements, à partir d’un état situé dans l’obscurité, il faut dessiner des cartes. Pour trouver les mots qui manquent, pour échapper à la fatigue qui nous livre à la langue de l’ennemi, pour repérer les contours de son propre champ parmi les bavardages et sous la surface. Le présent n’est pas contemporain, il est chargé des défaites du passé et de l’intelligence actuelle des responsables. Les gouvernants ont rebattu les cartes, portent des masques et utilisent des idiomes qui peuvent nous faire douter des axes de conflit. Le progrès, la solidarité et tout ce qui appartient à la gauche sont la principale rationalité du gouvernement, la « société » et l’« environnement » nomment des techniques d’annexion impérative à un pouvoir qui est technique et politique, moral et idéologique, scientifique et policier. Un pouvoir qui prend les traits de l’universel, d’une synthèse qui n’est pas seulement celle, invisible, de la technologie, des dispositifs et des flux qui régulent nos comportements par la douce poussée de la commodité, sur fond de solutions coercitivement suggérées par les écrans et les identités numériques, les divertissements et les procédures.
Cet universel devient au contraire, au contact de l’urgence, ce qu’il a toujours été : une imposition violente par le chantage, impérieuse, teintée de la dernière instance de la Morale, de la Vérité, de la Raison et du Bien commun. Une synthèse impérialiste et immanente qui efface ce qui se trouve sur son chemin, un tissu biopolitique continu qui ne doit pas être interrompu. Contre ceux qui échappent à un régime idéologique de vérité, aussi totalisant soit-il, il y a une inimitié féroce et politique qui a cependant des limites et une relativité : quel mélange annihilant de condescendance, de dépréciation et d’attention doit-on au contraire opposer à ceux qui nient l’imminence du péril commun et la responsabilité de le combattre ? L’urgence sociale, sanitaire, climatique ou démocratique concerne tout le monde, elle est étayée par des données objectives, c’est une évidence qui ne peut être ignorée et face à laquelle il n’y a aucune raison. L’appropriation linguistique et l’ethic washing sont des épiphénomènes contemporains de la faute ancestrale que l’homme de parole commet sur la peau de l’homme dans le besoin, qui sent sur son corps et au-delà du discours qu’il a été escroqué. L’escroquerie est un usage du mot qui se confond avec la réalité, qui creuse à la racine des certitudes sensibles, les rend atones, insinue le doute. Face à elle, l’homme du besoin – besoin de vérité et de communication avant tout – estime ne pouvoir réagir que par une violence muette (Dionys Mascolo).
Chacun de nous a personnellement assisté mille fois au grand spectacle qu’est un dialogue entre un homme simple et un praticien du langage clair. L’homme au langage clair parle, avance des raisons, s’appuie d’arguments innombrables : lui seul dispose de l’arsenal des arguments. Il a donc l’avantage. Il est irréfutable. Il a le dernier mot. L’autre, celui qui n’a pas de langage clair, parce que sa situation, qu’il n’a pas idéalisée, n’est pas claire, ne peut que se taire à la fin, et semble avouer son tort. L’instant d’après, on le retrouve honteux, mais persuadé qu’il a raison, sans raison claire. Il lui semble alors que la violence seule aura peut-être raison du langage clair qui lui donne tort. Et c’est juste. Le langage clair est une simplification. Ce n’est pas n’importe quelle simplification. C’est la simplification idéaliste. Pour être à la hauteur du manque de clarté de la révolution, il faut d’abord avoir renoncé à l’illusion rationnelle du langage clair[1].
Les soulèvements qui se succèdent contre la normalité, l’urgence, l’enfermement sanitaire ou la police, les non-mouvements qui donnent naissance à cette énorme fièvre de rejet qu’est une prise de pouvoir sauvage, anti-écologique, antisociale et irrationnelle, sont précisément cela.
L’humanité pose des questions auxquelles elle ne peut pas encore apporter de solutions. À la fois parce qu’il n’y a pas de sujet qui réponde à ce nom, une communauté d’espèces derrière la communauté du capital, et parce que le langage qui désigne les problèmes est une fausse monnaie. Si « solidarité » signifie mobilisation guerrière, surveillance panoptique, et marginalisation des contestataires, égoïste et inhumain est celui qui démontre, de là où il se trouve, que l’acceptation molle a des limites. La nouveauté qui marque le régime épistémologique actuel est que les signes mêmes du lien social et de la science deviennent le pur synonyme de la force gouvernementale et rien d’autre. Sous nos yeux, il y a un pluralisme de croyances et des ruptures épistémologiques au fond de la réalité, les visions alternatives prolifèrent, les récits et les noyaux de vérité se divisent et se multiplient sur le plan neutre et horizontal du même espace public d’expression numérique dans lequel le critère de certitude se perd, n’existe pas ou génère de la suspicion. Scientifique est seulement la mesure, la loi et l’imposition qui est décidée comme telle. Moral et responsable est le comportement qui accompagne la poursuite du circuit ordinaire de production et de consommation, dangereux et nihiliste celui qui au contraire le bloque ou l’entrave. Le travail, la consommation et la circulation sont du côté du bien, la protestation, le refus et même le doute sont anthropologiquement en dehors du spectre des motifs valables.
Première étape
La manière dont cette nouvelle morale et cette nouvelle épistémologie s’entrecroisent avec tout le continent des articulations numériques, que l’on résume par euphémisme avec l’étiquette d’« intelligence artificielle », doit être abordée de manière stratégique : un complexe d’options par défaut, de contraintes invisibles et de situations obligatoires qui se concrétisent dans des dispositifs technologiques et qui orientent notre comportement vers une accumulation incrémentale, une contrepartie de pouvoir renouvelée à chaque geste, acte, choix. Derrière ces options et ces traces se cache la fermeture circulaire de classifications continues – une idée de classification elle-même, déguisée et incrustée dans la matrice de la technologie (Kate Crawford, Dan McQuillan)[2] – qui enferme l’archaïque sous les voiles du progrès. Les anciennes formes d’oppression sont superficiellement recouvertes du maquillage des nouvelles, juste teintées de calcul algorithmique, comme dans ces interfaces télématiques qui simulent les réponses d’une IA pour le plaisir de l’utilisateur, cachant l’existence d’un opérateur humain. Lorsque l’on parle de puissance algorithmique, il faut garder à l’esprit que les dispositifs de classification et d’intelligence artificielle ne décrivent pas du tout – avec leurs pourcentages de précision prédictive et d’exactitude scientifique – les sujets et les comportements dont ils prétendent rendre compte de la réalité et dont ils induisent les décisions, mais qu’ils les créent à travers leurs propres catégories. L’extraction des données et leur imposition agissent par des effets de rétroaction, des boucles performatives qui réitèrent et cristallisent leurs résultats avec une vérification en retour, une adaptation des sujets à la vérité produite sur eux. La récurrence et la performativité sont les éléments qui rendent les données effectives et les confirment à leur tour, produisant l’illusion superficielle et rationaliste d’un regard désincarné et introuvable.
Cette idée de classification détermine, chaque fois qu’elle colle une étiquette sur quelqu’un, l’injonction de se conformer à la vérité positive que l’appareil d’objectivation propose comme cadre scientifique sur cette classe d’individus, conduisant à un degré supplémentaire de consolidation de la donnée dans le tour suivant de la spirale de renforcement. S’il n’est guère surprenant que les logiciels algorithmiques appliqués à l’organisation du travail, à l’incarcération, au fonctionnement des tribunaux ou à l’attribution des subventions, tracent les anormaux biais racistes et misogynes, la profonde violence de classe inscrite dans la vision du monde – et donc dans les archives de données – des institutions dont ils dépendent, il faut garder à l’esprit qu’il n’y a rien d’essentiellement nouveau dans tout cela. L’utilisation de critères mathématiques pour couvrir la circularité opérationnelle de son cadre d’investigation instrumentale (avec pour résultat qu’il est moulé et consolidé à chaque nouvel usage de l’instrument), le rationalisme psychotique et l’idée positiviste de modéliser la division optimale des choses, des comportements, des types de personnes, est ce qui unit la sphère de l’IA à la violence épistémique dévastatrice qui est un héritage de son ancêtre direct, la science statistique. Que tout l’attirail de cette science ait, depuis son origine, intimement pénétré le programme systématique de darwinisme social, de suprémacisme racial et d’eugénisme poursuivi par tous ses pères fondateurs – de Spencer à Galton, de Grant à Pearson – avec pour instance motrice la définition et la promotion des caractéristiques les plus « aptes » (fittest) au renforcement et à la reproduction de la machine sociale, n’empêche pas son vocabulaire et ses objectifs d’être encore consacrés au cœur du regard de l’État. Un cœur transplanté au centre de l’algorithme, où la « datafication » du monde ne reflète rien, mais induit, impose et enferme : c’est en raison de sa formidable efficacité par rapport à cet objectif que, malgré ses trous cognitifs constants et omniprésents, il poursuit son chemin à étapes forcées.
Crowdworking, tests et collecte de données sont réalisés par les sujets expropriés dans un mécanisme de réduction à la valeur, à une forme statique et figée, calculable, car capable d’une gestion probabiliste dont la finalité n’est pas cognitive, mais instrumentale : modéliser l’objet dont on veut restituer la vérité, dans un effet de rétroaction qui renforce de plus en plus le fondement du dispositif. Dans cette mécanique coexistent une virtualisation maximale et une intensité d’exploitation qui renvoie à une plus-value absolue, un extractivisme algorithmique à la fois physique et spirituel. En ce sens, des couches archaïques de temps se cachent derrière la façade smart ; le présent est cependant non contemporain (Ernst Bloch)[3] également parce que l’« humain » refoulé comme ouverture et sens, repos par rapport à la machine, par rapport au fond manipulable, émerge sous des aspects et des lexiques antithétiques à l’horizon du progrès et de la gauche. Petite parenthèse évidente sur l’évocation de l’humain qui est faite ici en opposition aux sirènes du « transhumanisme contemporain ». Déjà Heidegger, dans sa lettre à Jean Beaufret en 1969, dit que l’humanisme comme conception métaphysique n’a pas une assez haute idée de l’homme, qu’il réduit à la substance et au genre statique au lieu de l’ouverture, donc de la possibilité toujours incomplète. En ce sens, c’est la métaphysique appliquée à la technologie qui réside aujourd’hui dans le transhumanisme, mais avant cela dans toutes les classifications opérationnelles cachées derrière les dispositifs technologiques, qui réduisent l’humain afin de le fossiliser dans une identité, dans quelque chose de stationnaire et de séparable qui, une fois épinglé dans le quadrillage d’informations recueillies à son sujet, peut être traité à volonté. Les non-mouvements ou mouvements impurs qui débordent sur le répertoire des révoltes ne sont pas reconnaissables dans la grammaire politique qui s’est transmise au fil des décennies autour des filiations imaginaires de la séquence du mouvement ouvrier.
C’est pourquoi ces révoltes identifient – instinctivement, mais lucidement – leur ennemi dans la figure de la gauche[4], mais elles prennent automatiquement les traits de ce qui réagit à sa logique traîtresse. Ce glissement sémantique s’explique : le bien commun climatique consiste en la déclaration de l’état d’urgence et la revalorisation du nucléaire, le vert est le visage des restructurations capitalistes qui détruisent l’eau et la terre au nom des énergies renouvelables, et enfin une expérience de masse d’exclusion de la possibilité d’existence publique – soutenue par une licence télématique – devient le précurseur de nouveaux horizons de socialisation forcée. On comprend alors que les réponses à ces bonds en avant du commandement touchent tous les noyaux stratégiques de la domination avec une précision surprenante – mais parfois avec une spécularité nette. Les révoltes du futur seront anti-écologiques et « de droite », précisément parce qu’elles reconnaissent dans les bonnes raisons qui leur sont opposées une pure et simple technique gouvernementale qui vise à rendre muet. Mais être proscrit de l’existence publique, réduit à l’indicible et à l’irreprésentable, n’est pas nécessairement la condition de séparations plus fermes et plus agressives. Le conspirationniste, le no-vax, l’anti-occidental et le déserteur du bon front, sont une boîte opaque dans laquelle les cadres d’information risquent de s’échouer. On ne peut prédire ce qu’il en adviendra. Déclarer une urgence infinie sur laquelle fonder le fonctionnement du pouvoir comporte toujours le risque sous-jacent de préparer le terrain à une véritable urgence.
Folk Devils
La question brûlante qui se pose aux révolutionnaires qui ont le courage de ne pas se laisser aveugler est de savoir comment se positionner dans ce camp. Ceux qui ont vu dans les mesures d’urgence de la période pandémique une mobilisation totale qui ne laisse pas ses présupposés inchangés, ceux qui lisent dans ce qui s’est joué derrière et à travers les aspects sanitaires du Covid-19, un saut décisif qui laisse des traces, qui ne permet pas le retour à une quelconque normalité, doivent se doter de nouveaux outils. Si le déclin des principes hégémoniques caractérise un pouvoir anarchique et infondé, si la crise de la représentation (Camatte) laisse la valeur fonctionner comme une coquille vide qui se nourrit d’elle-même, comme un pouvoir nu, il semble que la possibilité d’une sécession extérieure et éthique existe encore, d’un trou dans le tissu du commandement, difficilement réductible et définissable. Qu’elle existe et qu’elle fasse peur. Les phénomènes dissidents centrés sur les pandémies, la santé, la guerre, l’unité sociale et le progrès sont cette dissemblance monstrueuse qui, réduite à une série de folk de vils photocopiés (no vax, poutinistes, conspirationnistes, négationnistes du climat, nihilistes pilleurs de banlieues), reflète un commandement moralement impératif parce qu’il réagit au vide des valeurs unitaires, irrémédiablement renvoyées à la pluralité discursive et épistémique. La gauche « radicale », quant à elle, exige des soulèvements, une transcendance, une vision d’ensemble et un horizon de sens (reconnaissable et crédible) qu’elle ne trouve nulle part et qu’elle ne connaît pas elle-même. Les innombrables invectives contre la subalternité anthropologique et culturelle des insurgés, le règne des individus souverains porteurs d’un modèle d’existence subordonné à l’hégémonie néolibérale, son autre visage, trahissent une incompréhension fondamentale de ce qu’ont toujours été les révolutions.
La conscience, l’être de la théorie et l’être de la classe, la détermination positive du projet politique à partir de l’expérience matérielle – la classe en soi et la classe pour soi – sont toujours un cercle vicieux qui se reproduit de la même manière, d’abord la tragédie et ensuite la farce. On ne se rend pas compte que les stigmates d’aujourd’hui sont les mêmes que ceux d’hier : du sous-prolétariat italien incendiant Piazza Statuto aux habitants des banlieues s’emparant stupidement et obstinément des marchandises. Certains en tirent au contraire les conséquences abjectes[5] : l’anthropologie capitaliste contamine en effet les soulèvements des racisés par la même négativité sauvage qui s’exprime dans tous les soulèvements. On s’empresse donc de tracer les lignes pour tenir les barbares à distance[6].
S’il est vrai que l’espace de circulation prend partiellement le relais de l’espace des sites productifs dans l’interrègne entre les répertoires d’action qui marque cet âge de transition, comme le note Joshua Clover, cela n’implique aucune « économie politique du conflit ». En suivant cette idée contradictoire, on recule sans cesse dans l’identification du critère où la lutte dans la lutte est possible et où, au contraire, la colère populaire est ontologiquement consignée – comme Clover l’a dit en substance à plusieurs reprises à propos des soulèvements de la phase pandémique – dans une direction politique réactionnaire. Tout ce qui reste, c’est une oscillation circulaire entre les deux contresens d’un déterminisme de la composition des classes et d’un fétichisme de la parole. Dans un cas, il y a une régression des répertoires formels – gestes et pratiques – vers la centralité des sujets, sociologiquement délimités dans la hiérarchie des relations capitalistes. On dérive alors mécaniquement la possibilité de la bifurcation des conflits d’une lecture marxiste obtuse des fractions sociales et des classes, mais surtout on tombe carrément dans l’erreur, car aux yeux de qui voit, les non-mouvements des gilets jaunes, le Convoi de la Liberté, les protestations contre le pass sanitaire ou même, il y a des années, les Forconi en Italie, sont unis non seulement par le même répertoire d’action, mais aussi par le même réservoir hétérogène de forces sociales prolétarisées. Reste la seconde option, qui replace pleinement le prisme des luttes de circulation dans le sillon de la gauche : l’étalon d’évaluation des luttes qui peuvent être rachetées, ce sont les énoncés qui se réfèrent au champ de l’émancipation, à un langage politiquement reconnaissable. Inutile de dire que ce critère ne fonctionne pas non plus, rétablissant également l’idée libérale stupide du conflit politique comme dialogue et échange de points de vue entre sujets (Wollheben, Torino) au lieu d’identifier les nœuds que les luttes touchent matériellement.
Dans un livre qui reste à ce jour parmi les meilleurs ouvrages sur Marx, parce qu’il met en évidence ses dettes métaphysiques à l’égard du projet de la technologie moderne, Kostas Axelos montre la fausseté de l’idée selon laquelle la dialectique entre deux classes ou forces sociales résout la fracture au sein d’une formation historique et permet de la surmonter : l’antagonisme dualiste est brisé par une troisième force qui fait irruption de l’extérieur et modifie le cadre de l’existence historique.
Le passage d’un stade historique à l’autre ne résulte pas de la victoire des exploités sur les exploiteurs, mais d’un épuisement interne et de la manifestation d’une nouvelle « troisième force ». L’antagonisme dualiste a été supprimé et dépassé par une troisième force qui a supprimé et vaincu les deux belligérants ; les Romains ont remporté la victoire sur les Grecs, et les Barbares ont supprimé le monde gréco-romain, qui n’a pas pu survivre ; et le Moyen-Âge a trouvé sa fin grâce au développement de la bourgeoisie et « indépendamment » de la lutte qui opposait les barons et les serfs. C’est pourquoi. Peut-on exclure que l’antagonisme actuel (capitalistes et prolétaires) soit supprimé et dépassé sans qu’il y ait une victoire définitive de l’un sur l’autre, mais le développement d’une troisième solution, qui peut certainement surgir de l’intérieur ?[7]
C’est de cette troisième force qu’il s’agit, de ce résidu par rapport au machinique, au visible et à l’exploitable. Une force profonde et cachée, qui ne devient substance que lorsqu’elle est déjà prise dans la machine extractive et computationnelle de l’algorithme ou de la surveillance biopolitique. C’est pourquoi l’écologie politique, en se présentant comme un programme de solution et de gestion rationnelles des retombées catastrophiques de la dystopie capitaliste, est essentiellement un extractivisme[8]. Parce qu’elle incorpore et digère dans les réseaux de l’économie ce qui était invisible à la quadrature moderne du sujet souverain et de la technique colonisatrice : la nature, les non-humains, la reproduction, le non-travail ou même le Dehors en tant que tel, qui cesse alors d’être. Comme Cesarano l’avait déjà vu en 73, l’utopie du capital n’est plus seulement l’expansion assimilatrice continue et de plus en plus désinhibée vers les ressources libres, l’appropriation débridée qui s’écrasera avec fracas contre le mur de nos limites biophysiques, mais peut et doit combiner ce visage avec l’assimilation de la conscience écologique comme exploitation extractive de la conscience de l’espèce. Nouveaux espaces, nouvelles préoccupations et solutions pour maintenir le même projet sous d’autres formes, en prenant enfin en compte que les acteurs de la planète sont connectés. L’écologie politique est le complément de vie terminal de l’économie politique.
Ce que l’on appelle le problème de la composition tourne autour du même nœud, mais en partie le malentendu : le tourbillon de subjectivités dispersées que l’univers totalisant du mouvement ouvrier laisse orphelines, à l’âge anarchique d’un capitalisme qui n’a plus de fantômes hégémoniques, donne lieu à une désorientation et à un champ d’expérimentation. Les politiques identitaires peuvent devenir, à partir d’une emprise écrasante, des « non-mouvements » qui se déplacent à partir de questions morcelées et fragmentées qui, à leur paroxysme, peuvent se transcender et perturber jusqu’à leur propre cadre de départ. Dans les révoltes, les éclats de la mosaïque postmoderne d’identités plurielles se nie elle-même, comme dans les anciennes saisons révolutionnaires, la classe devait se nier elle-même. Mais ici, il n’y a pas de transition dialectique qui se déroule d’elle-même, et personne ne se fait d’illusions à ce sujet. En même temps, la stratégie qui consiste à ajouter une lutte à une autre – racialisés plus exploités plus femmes plus précaires plus étudiants plus extrémistes éthiques plus… – ne mène nulle part, précisément parce qu’à l’apogée des conflits, les protagonistes, aux contours déjà précaires, se brouillent davantage. Il se peut donc que la question ne soit pas de composer les luttes à partir de leurs raisons et de leurs différences – avec le risque que le réseau vital de nuances et de plis reproduise le tissu enveloppant d’une raison politique démocratique (du parlement des choses au parlement des luttes), mais de rendre irrecevables les raisons des luttes elles-mêmes.
Un soulèvement d’automobilistes contre le coût de leur circulation forcée devient le site d’urgence d’un peuple qui n’existait pas (un populisme extatique, ont dit certains) ; la vague d’émeutes qui a suivi la mort de George Floyd acquiert une composition qui, dans sa forme la plus radicale, n’est même plus majoritairement noire ; enfin, les protestations contre les mesures sanitaires d’urgence pour contenir le Covid-19 contenaient en nuce le refus de la masse de se laisser gouverner. La classe sociale n’est donc pas l’une de ces boîtes d’identité, dans lesquelles la force subversive est réduite à un genre statique et à un contexte gouvernemental, mais précisément l’anonymat qui émerge lorsque ces boîtes sont brisées. Et donc, bien sûr, elle n’est pas une classe et ne peut pas être classée.
Ce qui reste à observer, cependant, c’est que les politiques identitaires, qui se reproduisent comme telles, sont des légitimations violentes de la normalité et des points d’application des opérations gouvernementales : il faut faire attention où l’on regarde, quel camp l’on choisit, parce que le langage de l’ennemi est inscrit dans les options les plus faciles. La restructuration excluante de l’espace public et l’environnementalisme, le féminisme[9] et l’idéologie du care qui se prêtent à une biopolitique autoritaire, la protection des minorités et les campagnes militaires, sont des dérapages tout aussi dangereux que, dans le feu des luttes, le mélange avec la nébuleuse qui répond à l’étiquette de la conspiration. Un mot qui englobe un dispositif mortel pour désamorcer préventivement toute arme critique[10]. C’est dans cette nébuleuse qu’émergeront les lignes de force de nombreuses luttes futures. Il s’agit alors de trouver un mode de convergence capable de déserter le camp ennemi, de poursuivre non pas la pureté du langage, mais la force réelle de la séparation. En ce sens, une lutte écologique contre l’impact des énergies renouvelables et de l’éolien ou contre la destruction verte d’un écosystème, par exemple, offre plus de possibilités que d’autres revendications. Soit on trouve le point de jonction entre les mouvements fallacieux de l’univers complotiste – les objets politiques non identifiés de la rébellion contre la gauche – et de l’autre côté ce qui reste de plus vital dans les luttes environnementales, au-delà et en marge de l’écologie politique, soit ces dernières sont irréversiblement vouées à la récupération et à l’utilisation par l’ennemi. En même temps, la nébuleuse des régimes de vérité alternatifs, laissée à son devenir spontané, est capturée par la bifurcation réactionnaire. C’est le conspirationnisme qui peut sauver les luttes écologiques et en racheter le sens, en dehors et contre la gauche, et non l’inverse. Tant pis si l’on veut expliquer aux non-civilisés que l’ennemi n’est pas la Grande Réinitialisation, mais le capital. Il est clair qu’une solution révolutionnaire et stratégique à ces problèmes ne peut se réduire à la vieille idée pédagogique de la lutte pour l’hégémonie, de la bataille des idées et des propositions. D’autres éléments doivent être mis sur la table.
Formes de séparation
Par ailleurs, il est évident qu’autour du concept de « transcrescence » des luttes, de la manière dont une séquence de révoltes peut déboucher sur un devenir révolutionnaire, il y a le grand vide de notre côté. Un vide théorique et stratégique, mais avant cela un vide imaginatif. Il est clair que, hormis les nombreuses recettes sociales-démocrates aux prétentions peu substantielles à la radicalité – pouvoirs constituants, pouvoirs instituants, pouvoirs interstitiels, doubles pouvoirs, néo-statalisme et néo-mutualisme, j’en passe –, toutes les esquisses actuelles d’une pensée stratégique révolutionnaire passent par le nœud de l’« autonomie ». Un mot réinventé au-delà de la référence ouvrière en mille sens, formulations et perspectives, qui ne nous laisse d’ailleurs rien de clair et d’univoque entre les mains.
D’une part, la critique historique du consiliarisme et de l’idée d’autogestion par Bordiga, mais en général au compromis de concevoir le renversement révolutionnaire et le communisme en continuité avec la société capitaliste. Une continuité avec ses appareils politiques dans le cas du réformisme et avec ses organes de gestion économique dans le cas du mutualisme ou du consiliarisme. Or, dans Gli scopi dei comunisti, Bordiga voulait s’attaquer à la position de l’Ordine Nuovo lors de l’occupation des usines. Mais si les institutions qui enjambent la grande catastrophe du mode de production actuel qu’est la révolution communiste, en réduisant la profondeur de son schisme, ne concernent plus la classe ouvrière, mais un autre sujet – ou non-sujet – la critique ne perd pas son acuité. Après tout, la thèse de Phil Nell[11], lorsqu’il rejette les ambitions vagues des îlots libertaires quant à la puissance d’une dynamique insurrectionnelle qui doit naître de la limite immanente des luttes de classes, insiste encore sur ce point : soit la proximité communiste autosatisfaite, soit l’expérience des révoltes. Et il n’a pas tort.
D’un autre côté, il y a une série de positions qui, de diverses manières, tentent d’identifier autour de l’idée d’autonomie – et de composition entre les formes de vie autonome qui surgissent au sein des luttes localisées – un type de soustraction offensive qui répond au besoin de durée organisationnelle au-delà de l’événement de la révolte, sans reculer devant la primauté de la confrontation. C’est l’autonomie dans le conflit qui répond à la profondeur destructrice et déstructurante des soulèvements pour rendre le schisme habitable et dense, comme l’a récemment écrit Adrien Wohlleben[12]. Il ne fait aucun doute que c’est la voie à suivre. D’un autre côté, construire des îles n’est pas, comme l’explique clairement Jérôme Baschet[13], la même chose que s’enfermer dans des îlots.
Les problèmes, énumérés brutalement, sont essentiellement de deux ordres : le premier concerne la possibilité d’une récupération politique qui met facilement à mal les développements des luttes « territoriales », surtout si la clé du renforcement de leur infrastructure autonome qui se condense dans le temps réside dans une idée de « composition » qui peut se décliner de multiples façons. En effet, une chose est de combiner des rythmes et des intensités politiques qui trouvent un équilibre capable de monter en puissance en fonction des facteurs conjoncturels, voire de mélanger les langues et les attitudes, pour faire de cette rencontre une opération éthique et stratégique qui doit coïncider avec le geste de la destitution. Une autre idée est au contraire, toujours à l’intérieur de luttes qui se déplacent souvent dans la boîte de Pandore de l’écologisme, – on peut relire les lignes de Cesarano, en 73, sur la « civilisation de la famine », trop vite rejetée et moquée – de faire la combinaison entre les sujets politiques sur le terrain.
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les mobilisations qui touchent aux domaines du vert et de l’environnement qui, comme quelqu’un l’a souligné à juste titre, ont supplanté la Société en constituant une position extra-terrestre et de survol par rapport à laquelle les schismes et les fractures sont réabsorbés dans la généralité cohésive qui garantit à la gouvernance capitaliste son référent inerte à gérer[14]. Être extrait et absorbé, réduit à la raison, c’est l’instance de séparation et de la destitution en tant que trajectoires qui ne sont pas réduites aux critères d’une possibilité de discussion démocratique, qui ne tombent pas dans l’horizon analysable des problèmes. En ce sens, encore, l’écologisme est extractif dans la mesure où il intègre l’indicible de la séparation – le refus qu’il affirme – et le recode dans les termes incurablement démocratiques des questions, des propositions et des solutions. En fait, le plus urgent est de développer des luttes sur les territoires comme milieux de vie à défendre, cristallisées dans des rapports de lutte, hors du cadre de l’écologisme gouvernemental et contre lui : si les externalités destructrices de la machine computationnelle de l’économie sont un terrain incontournable, ceux qui interprètent un morceau de ces externalités comme une crise à gérer selon une morale technico-répressive et impolitique au nom de laquelle les conflits disparaissent – les acronymes sont différents en Europe – n’appartiennent pas au champ des alliés possibles.
C’est précisément parce que la survie biophysique de la planète, encodée dans les termes de l’écologie, est un problème qui fait époque, qu’il divise les axes de reconnaissance et de confrontation de manière inédite et complexe. C’est précisément parce qu’il est le problème de notre temps qu’il ne peut être réduit à la surface discursive, mais qu’il doit être compris dans la profondeur avec laquelle il perturbe les identités et les réponses politiques : autour de lui se jouent de nouveaux fronts polarisants, opaques, difficiles. Il faut trouver des alliances qui permettent de ne pas aplatir les résistances territoriales dans un camp de gauche foncièrement hostile, et ainsi garder la porte ouverte à ces indisponibilités qui tissent l’écheveau de l’écologie avec des approches moins évidentes et unanimistes que celles de l’activisme climatique. Ceux qui résistent aux énergies renouvelables et aux dispositifs de surveillance smart[15] qui remplissent les villes de caméras au nom du contrôle des émissions, ceux qui ne veulent pas payer les surcoûts du carburant et du chauffage pour cautionner une « transition écologique » qui n’a pas de sens (comme l’explique Fressoz, il n’y a jamais eu, dans l’histoire du capital, de transition énergétique), attaquent la catastrophe environnementale d’un point plus risqué et plus avancé.
La question est bien de rechercher les traces du conflit, souterrain et vilipendé, qui menace l’entente catastrophique entre le continent intelligent, l’accumulation verte et les mailles de la société de contrôle : course aux énergies renouvelables au détriment des territoires habités, « Zcr » et villes des 15 minutes équipées d’yeux électroniques pour sélectionner et enregistrer les flux de transit dans les centres urbains (et projets annexes de vidéosurveillance et de détection biométrique), rocades autoroutières au cœur des recettes du renouveau vert, « citadelles de la santé » asphaltant des parcs et des lieux de rencontre déjà traversés par la densité de l’usage commun. Chercher systématiquement ces obstacles et ces entraves, c’est y déceler une autre vitalité, un refus irréductible de se plier à l’idée hégémonique du monde et de l’existence. Cela va au-delà de la cohérence argumentative de ces parcours, qui est d’ailleurs beaucoup plus solide – souvent et volontiers – que la fameuse machine de l’anti-complotisme ne veut le faire croire. Le présent est plein de noyaux dissemblables de refus et d’indisponibilité, potentiellement en guerre, au milieu desquels couvent des voies de sortie et de désertion. Entrer dans ce monde souterrain signifie toutefois renoncer à une certaine logique de visibilité et d’accessibilité propre à la politique, avec son attirail de propagande et de consensus. Il s’agit d’entrer dans l’ombre des conspirations et des solidarités cachées qui vont au-delà de la représentation et de l’identité. Dès son origine, le marxisme a voulu libérer le mouvement ouvrier de cette dimension de promiscuité originelle avec son ombre conspiratrice : il l’a fait en déclarant la guerre aux « sectes » et aux sociétés secrètes, en proclamant la nécessité d’une politique de masse, représentative, publique et en plein jour. Aujourd’hui, se réapproprier cet espace, c’est chercher des ententes en dehors de la grille de reconnaissance que fournit la représentation politique, c’est regarder la matérialité des rencontres contre quelque chose que l’on méprise, pour un usage vital que l’on veut préserver ou affirmer ensemble. Cela ne peut se faire qu’en dehors de la rationalité transparente des propositions et des programmes.
La Grande Révolution
Le geste qui accompagne cette attitude éthique et stratégique de séparation est donc une recherche permanente de foyers de dissension et de caillots d’intensité qui peuvent diviser la machine sociale ou la gripper, multipliant les fractures au lieu de les composer. Face à cette tension éthique, le lemme de la « révolution » – en tant que concept politique et héritage idéologique – est le signe avant-coureur d’une lourde hypothèque. Un regard rapide sur la gestation turbulente et orageuse de ce concept pose d’énormes problèmes quant à son étreinte mortelle avec la constitution moderne du politique : les révolutions astronomiques façonnent le sens du mouvement révolutionnaire (Polybe), puis vient la « Révolution » qui est inéluctablement tenue par les premiers pas de la civilisation bourgeoise, à partir de la date symbolique de 1789. Sur le sens de la Grande Révolution, comme l’appelle Kropotkine, s’est joué un théâtre de lectures qui a dessiné, à travers l’interprétation historique de ces événements, la projection des positions et des acteurs qui ont marqué les vicissitudes du mouvement ouvrier. À travers aussi les bilans faits par la pensée révolutionnaire, de Mascolo à Guérin, de Camatte à Rocker. Aujourd’hui, nous, révolutionnaires, devons nous confronter à l’idée de souveraineté que porte en lui le concept de révolution, au-delà des querelles terminologiques, pour marquer avec plus de clarté et de profondeur le pathosnécessaire de la distance qui nous sépare du marécage de la gauche. Et de la catastrophe de la modernité occidentale.
Dans la pensée de Saint-Just, premier créateur de la catégorie politique moderne de révolution, on trouve une véritable métaphysique de l’institution : « […] tout chemin qui conduit à l’ordre est pur » (Saint-Just, L’esprit de la Révolution). Une métaphysique articulée et composite qui permet de saisir les enjeux de ce concept, d’en entrevoir les fruits. Dans les luttes sanglantes qui ont émaillé les années de la « Convention nationale », il est en effet frappant de constater à quel point le vocabulaire des républicains – et de Saint-Just en premier lieu – s’organise autour de la polarisation entre le champ positif de la « représentation nationale », flanqué du terme impersonnel de « souverain » (« tout ce qui est en dehors du souverain est ennemi »), et aux antipodes le spectre de l’anarchie, brandi comme une menace par tous les prétendants. Brissot et les Girondins dénoncent l’anarchie provoquée par les Sanculots et les clubs jacobins : « C’est dès le commencement de la Convention que je dénonce la présence en France d’un parti désorganisateur, qui cherche à dissoudre la république au moment où elle naît. L’existence de ce parti a été niée, les incrédules de bonne foi doivent maintenant se déclarer convaincus ». Saint-Just et les Montagnards accusent leurs adversaires de conspirer pour répandre le spectre de l’anarchie et la produire en attendant, fragmentant ainsi la république : « l’anarchie a été le prétexte des conspirateurs pour comprimer le peuple, diviser les départements et les armer les uns contre les autres ».
Que la représentation souveraine soit divisée est la crainte obsessionnelle qui anime les Jacobins, au point que lorsque Saint-Just intervient sur la subdivision de la France en départements, le quadrillage sans ornement (Piero Violante, Lo spazio della rappresentazione) imposé un pays par le gouvernement révolutionnaire – ce paradoxe absurde, dira Jean Varlet – préconise un découpage fondé sur l’unité de la population et non du territoire, précisément parce que ce dernier éclipserait la possibilité de la division et du fédéralisme honni. Trois facteurs se conjuguent dans la vision révolutionnaire de Saint-Just, comme on l’a déjà noté : l’héroïsme, la terreur et les institutions. L’héroïsme, c’est l’esprit révolutionnaire, d’« excitation constante », qui fait de Saint-Just le créateur, comme le note Camatte, de l’idée moderne de révolution permanente : « ce qui n’est pas nouveau dans un temps d’innovation est pernicieux », écrit-il dans le célèbre Rapport sur le gouvernement du 10 octobre 1793. Et encore, dans le même discours : « Ceux qui font des révolutions dans le monde, ceux qui veulent faire le bien, ne doivent dormir que dans leurs tombeaux ». Le chef jacobin va même jusqu’à parler d’un état d’« anarchie salutaire » qui doit préserver la naissance de la liberté du retour de l’esclavage, utilisant ainsi de manière tout à fait inédite le concept d’anarchie comme synonyme d’émancipation.
La terreur est l’instrument nécessaire pour défendre la république contre le désordre et exorciser la division, en étouffant les ennemis de l’ordre révolutionnaire. Elle a le défaut de tarir les ressources de l’élan populaire qui nourrit l’héroïsme et consolide la vertu républicaine, comme le rappelle encore Miguel Abensour à propos de Saint-Just. Et puis il y a les institutions, la Constitution qui met fin à une salutaire anarchie et donne un cadre stable à l’exercice de la vertu par le droit. C’est le point central, la Vertu, autour duquel s’articule la théorie de l’institution révolutionnaire. La Grande Révolution représente, comme l’explique Camatte, un passage où le flux dissolvant du capitalisme détruit les liens antérieurs entre les hommes, mais est encore incapable d’en construire de nouveaux : c’est pourquoi elle doit se poser comme constituante et instituante, visant à établir la vertu du citoyen comme modèle normatif et horizon de valeur, véritable type d’homme sur lequel peut s’appuyer la représentation de la communauté. Avant de se débarrasser de cette unité de justification, la civilisation capitaliste devra réaliser sa domination réelle. C’est pourquoi nous trouvons chez Saint-Just à la fois le germe moderne de la révolution indéfinie et du processus pur, sans sujet et sans fin, et l’idée de l’ordre comme représentation qu’il partage avec un auteur comme Sieyès, mais aussi, au fond, avec le vieil ordre monarchique. En fait, la centralisation et la souveraineté qui font place au processus révolutionnaire sont celles d’un nivellement et d’une réduction à l’unité qui se joue contre l’espace gothique (Violante encore) de l’ancien régime aristocratique, avec sa trame de franchises et d’asymétries, de prérogatives et d’inégalités, mais aussi contre toute autre rigotisation de la société qui menace l’ordre à partir de la pulsion populaire, et non aristocratique. En effet, on peut aisément affirmer que l’architecture juridique conçue par Sieyès visait avant tout à contenir ce second esprit partisan, et non l’esprit monarchique (Roberto Zapperi, Alle origini del concetto di rivoluzione borghese). En effet, le durcissement de l’ordre et la centralisation répressive qui s’opèrent en 1973, explique Daniel Guérin, sont d’abord dirigés contre les Hébertistes et la « gauche ». L’image symbolique du pouvoir qui prévaut est toujours celle de la sphère et du centre qui rayonne sans entrave sur tous les coins du territoire, si chère à Louis XVI.
C’est que si dans la Révolution française – la mère de nous tous, dit Kropotkine – se trouvent in nuce les courants du mouvement révolutionnaire ultérieur, en premier lieu la libertaire et l’autoritaire et jacobine, il faut cependant identifier les limites de cette filiation. S’il est certain que l’ensemble des inventions et des formes d’organisation qui animent la tradition populaire entre 1789 et 1793, dans la continuité d’un parcours beaucoup plus long, sont un trait du devenir révolutionnaire qui traverse l’histoire des opprimés, il est important de comprendre que ni la représentation constituante, ni la révolution permanente ne sont un héritage pour notre parti. Ces deux pôles entrent dans la machine ontologico-politique du moderne qu’une agir destituant e doit fissurer. Approfondir et tisser un dessin souterrain de formes et d’usages capables d’affecter les luttes sans se mettre à leur tête, de vitaliser une autonomie dans le conflit sans le langage de la politique, c’est aussi changer les coordonnées qui nous lient à des origines imaginaires. Ni progrès subversif, ni régulation politique de l’égalité, mais invention d’une nouveauté radicale dans le réservoir des hérésies communalistes, des séparations et des sécessionnismes éthiques. Nous sommes le parti désorganisateur.
Conclusions provisoires qui sont pas là
En résumé. Certaines conclusions provisoires qui doivent être tirées concernent l’immédiat : les fractures dans le bloc de granit de ce temps présent n’ont pas besoin d’être inventées par « nous », il suffit que nous soyons capables de les voir. Les intrigues souterraines de dissidence et de refus prolifèrent violemment autour des enjeux de ce moment historique, de la technologie au changement climatique, mais elles le font dans la confusion la plus totale. Une confusion qui n’a d’égale que celle de notre propre camp, dispersé et réduit au strict minimum, en proie aux remises en question, aux trahisons et aux appels à la responsabilité sociale. L’urgence ne se résout pas, en revanche, avec l’autonomie ou les petits groupes : il faut de la régulation, il faut du commandement, il faut de l’ordre et des mesures à la bonne échelle. Face à l’état d’exception, il faut des mesures d’exception, et calmer l’intempérance. Il serait fastidieux de revenir sur l’extrême stupidité de cette simulation de force, de réalisme et de prévoyance stratégique, qui afflige les générations de la gauche, même de lextrême gauche, depuis le « Manifeste des 16 » jusqu’aux alignements sans fin qui débouchent invariablement sur les mobilisations générales des maîtres. Autant dire que le plan de la réalité de ces conversions à la realpolitik est à chaque fois le mauvais, c’est le déchet et la coquille vide que laisse le pouvoir, sur lequel les révolutionnaires d’hier arrivent toujours en retard, défaite pour défaite, tragédie pour farce. À chacun de remplir la boîte vide de cette alouette et d’y puiser les exemples qui lui viennent à l’esprit.
Tout aussi inopérantes sont ces minorités de subversifs qui, ancrés dans leur propre bagage idéologique, veulent apparaître sur la scène du soulèvement avec la vérité en poche : sans un lourd fardeau de faux tactiques, mais avec la revendication tout aussi écrasante du pouvoir thaumaturgique de la parole. L’éternelle chute dans le vide des élaborations les plus précises et des efforts de clarté les plus ingrats ne suffit pas à dissuader cette catégorie de l’efficacité de la formule programmatique et théorique qui transformerait la tour de Babel des soulèvements populaires – de plus en plus contaminée par l’irrationalité et la saleté – en une critique précise de l’appareil militaro-industriel, de la biotechnologie ou du capitalisme cybernétique. Loin des déviations du réformisme, du particularisme, puis du conspirationnisme et des pulsions réactionnaires, pour découvrir le fonds positif de ces luttes : mais à force de gratter le vernis, on reste dans l’insignifiance, au mieux celle des Cassandre.
Comme on peut peut-être le deviner d’après la progression rhapsodique de ce texte, la proposition à exposer est celle d’une voie moins immédiate. Une voie qui peut s’appeler séparation, destitution, soustraction, sécession conflictuelle, mais qui en tout cas se distingue clairement à la fois du tournant réformiste qui conduit à rejoindre les rangs de la gauche (par peur des pandémies, du fascisme, des barbares aux portes), et de la reproposition du projet révolutionnaire comme un piège de l’antagonisme. Ces deux solutions s’enracinent dans l’arsenal de la politique comme préparation d’une avant-garde, d’une minorité directive porteuse d’un projet universel, d’un salut et d’une recette. C’est le dogme de la visibilité et de la portée qui conduit à une récupération constante. Or, même d’un point de vue strictement stratégique et en calculant l’efficacité, tout cet arsenal conduit toujours et partout à la défaite et à la désorientation. Il vaut la peine d’emprunter une autre voie, d’essayer de donner une consistance éthique et humaine à une force commune qui consiste en deux choses très simples : des formes de nature très variée, mais coordonnées et capables de discuter, du collectif d’étude au fonds de solidarité, de la coopérative agricole à la revue, qui pratiquent des expériences de soustraction créative et sont les germes de petites infrastructures capables de s’unir, donc à vocation expansive ; des groupes capables d’écouter les luttes et les bouleversements pour partager ressources et capacités, techniques de rue, offensives et matérielles.
Ce deuxième point implique de se concevoir comme une minorité agissante autrement que par la voie politique, par le lexique militant du prosélytisme et de la proposition. C’est d’abord se tenir ouvert à l’événement vivifiant des révoltes quand elles se produisent, avec sa propre autonomie pratique d’initiative et de conflit, et aussi être capable de penser les moyens qui permettent aux mobilisations de sortir de leurs propres impasses dans la durée, au-delà même des objectifs intermédiaires. L’étiquette de destitution, en dehors des torsions académiques ou idéologiques, que signifie-t-elle vraiment ? Et aussi se différencier du protocole de l’activisme, qu’est-ce que cela implique ? Se retirer dans l’inaction ? Certainement pas, mais il s’agit de donner corps à ces indications par un débat plus large. Les mouvements de protestation de ces dernières années ont déjà montré qu’ils étaient capables d’atteindre par eux-mêmes un degré respectable d’intensité conflictuelle, mais ils s’arrêtent toujours à un seuil critique au-delà duquel l’effervescence s’éteint. Si la solution de l’entrisme institutionnel fait défaut, mais a déjà fait ses preuves là où elle a eu de l’espace, qu’est-ce qui nous attend au-delà de la circularité des mêmes pratiques ou de l’agitation d’un insurrectionnalisme vide ? C’est à ces questions qu’il faut répondre de la manière la plus incisive : ce n’est pas d’une nouvelle Théorie dont nous avons besoin, mais d’une réflexion conjoncturelle, en situation, sur les routes de parcourir. Et surtout, il est nécessaire de rechercher ce que les luttes peuvent être au-delà de leur clôture, de poursuivre stratégiquement un maintien non « politique » de leur héritage au-delà de l’impasse du débouché révolutionnaire, au-delà d’un antagonisme symétrique qui les écrase et d’une neutralisation réformiste. Rechercher systématiquement les conflits qui brisent l’unanimité, construire l’organisation pour les nourrir, aiguiser la sensibilité intellectuelle pour comprendre leurs implications. Ce sont des questions, certainement pas des réponses. Mais à partir de là, une certaine idée de l’autonomie, qui a toujours cédé le pas à d’autres positions et tendances, à la centralisation et à l’accélération des solutions les plus faciles et les plus directes, peut être imaginée au-delà du cercle ontologico-politique du moderne. Au-delà même d’une idée de la Révolution qui nous condamne à en être les Sujets, et en attendant à administrer la misère politique que la grande attente nous livre. Une dynamique révolutionnaire est au contraire quelque chose d’autre, que nous ne pouvons imaginer que par flashs.
Le cycle des émeutes et des places occupées qui a marqué les deux premières décennies des années 2000 s’est achevé sur quelques formes déracinées, sur une forme en particulier. Après avoir détruit les tissus d’identité et de représentation qui innervaient les luttes du XXe siècle – classe et nation d’abord, mais comme concepts politiques –, les gestes de la révolte et les germes du « commun » se réitèrent de manière circulaire. La révolte est le degré zéro de l’organisation après l’absorption et la destruction du Grand Dehors structuré du mouvement ouvrier, mais elle est aussi le symptôme salutaire de sa crise. La commune apparaît dans l’« être ensemble » peu concluant de ces places qui, décidées à ne pas se refermer, mais déprivés de toute expérience partagée, se plient aux formalismes de la parole. Dans cette agitation de rencontres au-delà du sens qui cherchent dans le vide, même en période de pandémie, quelque chose bouge qui peut se transformer, au milieu duquel chercher.
Michele Garau
[1] D. Mascolo, Le communisme. Révolution et communication ou la dialectique des valeurs et des besoins (1955), Lignes, Paris 2018, p. 559.
[2] K. Crawford, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA, Bologna, Il Mulino, 2022. D. McQuillan, Resisting AI. An Antifascist Approach to Artificial Intelligence, Bristol, Bristol University Press, 2022.
[3] E. Bloch, La non contemporaneità e il dovere di renderla dialettica (1963), in Eredità di questo tempo, Milano, Mimesis, 2015.
[4] E. Riquelme, « Défaire la gauche », Entêtement, Mars 2023. En ligne : https://entetement.com/defaire-la-gauche/
[5] I. Segré, « Où situer l' »extrême gauche ». Réflexions sur les nuits d’émeutes », lundimatin, 11 juillet 2023. En ligne : https://lundi.am/Ou-situer-l-extreme-gauche
[6] V. Gérard, Tracer des lignes. Sur la mobilisation contre le pass sanitaire, Paris, Mf, 2021.
[7] K. Axelos, Marx pensatore della tecnica (1961), Milano, Sugar, 1963, p. 83.
[8] À ce sujet, les réflexions lucides de Mohand dans le texte en deux parties Bifurcation dans la civilisation du capital. Sur le site www.entetement.com
[9] Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la parabole du féminisme, à commencer par l’opposition séculaire entre le paradigme de l’émancipation et celui de la libération, qui s’affrontent depuis longtemps, comme le rappelle Mario Tronti, dans ce champ de discours et de pratiques. Le premier en recherchant la reconnaissance juridique des droits, le second en cultivant des gestes concrets capables donner puissance . Ne croyez pas que vous avez des droits, tel est le titre d’un livre qui semble appartenir à un passé lointain. Tout comme les réflexions de Luciana Percovich dans la préface du livre La coscienza del corpo (La conscience du corps) semblent un écho du temps, où elle rapporte les considérations d’une partie du mouvement féministe italien qui, au moment de la légalisation des Consultori Pubblici (Consultations publiques) et de l’approbation de la loi 405 de 1975, a saisi les risques d’intégration et de récupération, de soustraction de pouvoir, que cette reconnaissance légale entraînait : « La même année, pressée par la loi sur les Consultations publiques (…), promptement (!!) adoptée pour combler un vide juridique entre les droits des femmes et des hommes, et les droits des hommes et des femmes sur le marché du travail, la loi sur les droits des femmes a été adoptée pour protéger les droits des femmes.), adoptée pour endiguer un phénomène qui se répandait comme une traînée de poudre et tenter d’en reprendre le contrôle dans les mains institutionnelles, médicales et religieuses, les femmes qui avaient créé ou créaient depuis un certain temps les différents centres de consultation féministes ou les centres médicaux pour femmes se sont trouvées confrontées à la nécessité de décider, dans un délai très court, de se transformer en institutions de service public ou d’accentuer leur caractère de « laboratoires politiques » de la santé et de la recherche médicale.
[10] Un résumé très clair des contradictions de cette catégorie : A. Lolli, Complottismo e marxismo, en ligne : https://www.machina-deriveapprodi.com/post/complottismo-e-marxismo. Également la récente contribution au volume M. POLESANA, E. RISI, (S)comunicazione e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 2023.
[11] P. Neel, Hinterland, Reaktion Books, Londres, 2018.
[12] A. Wohlleben, Autonomy in Conflict, en ligne : https://illwill.com/autonomy-in-conflict. Les contributions de Farrel et de Molinari sont également disponibles à l’adresse – avec une orientation plus strictement stratégique – cette dernière étant plus problématisée. H. Farrel, The Strategy of Composition, en ligne : https://illwill.com/print/composition ; N. Molinari, Breaking the Waves, en ligne : https://illwill.com/breaking-the-waves. La différence entre ces contributions et celle, plus ancienne, de Mauvais Troupe est que, dans cette dernière, l’autonomie des formes de vie ne s’achève pas, mais prolonge le moment de dénuement.
[13] J. Baschet, Basculements. Mondes émergents, possibles, désirables, Paris, La Découverte, 2021.
[14] Ni écologie ni société, en ligne : https://lundi.am/Ni-ecologie-ni-societe
[15] Deux exemples. La smart city control room est un système mis en place par la municipalité de Venise et la société Tim qui, grâce à un réseau de caméras, a créé dans le quartier général de la police locale situé sur l’île du Tronchetto, une salle qui permet de voir toute l’étendue de la ville, chaque rue et chaque point du territoire urbain. Sur les objectifs et les ambitions de ce centre de collecte de données : https://www.ilpost.it/2022/06/10/venezia-smart-control-room/ La même expérience est proposée pour la ville de Florence. Le smart citizen wallet est une proposition expérimentale, appliquée par la municipalité de Bologne, d’un permis de conduire numérique pour les citoyens vertueux, basé sur un système de crédit qui devrait garantir des réductions et des avantages économiques – par le biais d’un mécanisme d’acquisition de points – aux citoyens qui, par exemple, ne prennent pas d’amendes, sont responsables dans leur consommation d’énergie et adoptent d’autres comportements méritant d’être pris en compte.Assemblea Romana contro il Green Pass, La variante dell’indisciplina. Sulla lotta contro il green pass e il dominio dell’emergenza, en ligne : https://www.nogreenpassroma.org/2023/02/07/11-febbraio-2023-carnevale-in-mascherina/